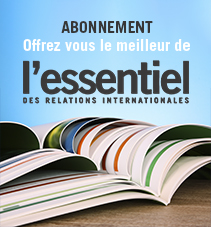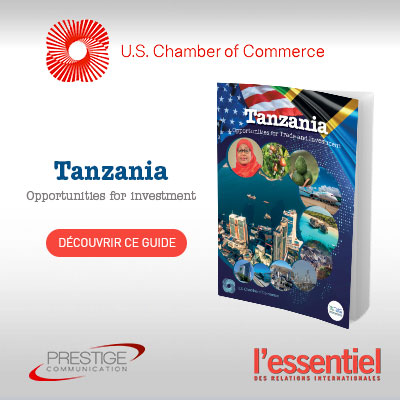Le bulu tangkis (« badminton » en bahasa indonesia), est un sport national dans l’archipel. Pratiqué par l’ensemble de la population, sur toutes les îles et dans toutes les régions, il est l’une des seules disciplines à rapporter des médailles au pays. Mais il est bien plus que cela…
Par Raphaël Sachetat
Rexy Mainaky, Hendra Setiawan, Susi Susanti, Taufik Hidayat : ces noms sont souvent inconnus en France, mais résonnent aux oreilles des Indonésiens comme des Zidane et Mbappé locaux. Ces véritables stars ont ramené en leur temps, à Jakarta, une médaille d’or olympique. Ce sont 22 médailles au total, dont 8 en or, qui ont été raflées par le pays depuis l’arrivée du badminton comme discipline olympique en 1988. Soit 55 % de toutes les médailles du pays. Les champions olympiques deviennent des légendes, et continuent parfois leur carrière bien au-delà des courts — comme par exemple Taufik, médaillé d’or aux Jeux d’Athènes en 2004, qui occupe désormais un poste de Ministre adjoint de la Jeunesse et des Sports au Gouvernement.
Ce contenu est réservé aux abonnés
Un état d’esprit source de rapprochement
Mais le badminton, en Indonésie, c’est bien plus qu’un pourvoyeur de médailles. C’est un état d’esprit. Un mode de vie. Partout, les gens jouent. Pieds nus, dans les parcs, dans les cours d’école, les garçons comme les filles. Et aussi dans les milliers de gymnases des villes et des campagnes, où de futurs champions rêvent de succéder à leurs idoles ; dans des académies de badminton gérées par d’anciennes stars ; dans des clubs privés, souvent sponsorisés par les plus grandes entreprises du pays. La fédération nationale de badminton, PBSI, travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement et offre aux jeunes la possibilité de voyager à travers le monde pour représenter les couleurs du pays. Et ce, quelle que soit l’origine des joueurs, avec un véritable syncrétisme sportif au sein des équipes nationales — toutes les ethnies, religions y sont représentées, ce qui donne au peuple indonésien, notamment lors des grandes compétitions par équipes, un sentiment d’unité assez incroyable, dépassant les différences et unissant le peuple derrière ses champions.
Ce sport est aussi une passerelle diplomatique intéressante, qui provoque des rapprochements entre les peuples en dehors des frontières du pays. Ainsi Tony Gunawan, ancien champion olympique, avait trouvé dans son partenaire américain Howard Bach un compagnon de fortune qui allait les porter jusqu’à la médaille d’or des Championnats du monde organisés à Anaheim en 2005. Nombreux sont les anciens joueurs indonésiens, fins tacticiens, qui œuvrent en tant qu’entraîneurs dans des pays internationaux — ce faisant, ils font rayonner le pays à l’étranger avec bien souvent de nombreux succès également dans ce nouveau rôle. Enfin, de plus en plus de joueurs, européens notamment, viennent participer à des stages intensifs de badminton, attirés non seulement par l’expertise locale, mais également par le pays et sa culture, dont le badminton devient un véritable ambassadeur.
Istora Senayan, l’antre du badminton international
Le badminton en Indonésie, c’est du sérieux. Mais c’est aussi la fête. La plus grande fête mondiale de ce sport : tout le monde s’accorde à dire que le bulu tangkis est célébré ici comme nulle part ailleurs. L’Open d’Indonésie fait partie des quatre plus gros tournois au monde et accueille la crème des joueurs dans un écrin unique. L’atmosphère qui y règne est réputée au-delà des frontières. « Jouer au badminton à Istora Senayan, c’est juste incroyable. On y chante, on y danse, les spectateurs font tellement de bruit qu’on ne s’entend même pas entre nous sur le court », s’enthousiasme Thom Gicquel, l’un des meilleurs badistes français, qui a récemment remporté ce tournoi avec sa partenaire de double mixte Delphine Delrue — une première pour des Français. « Ce sport est ici une véritable religion d’État, et tous les joueurs au monde adorent cette ambiance unique », abonde la Française, qui vient par ailleurs avec Thom de remporter une médaille de bronze aux Championnats du monde à Paris.
Le spectacle est autant sur les courts que dans les tribunes, où des écoles de danse se succèdent au rythme des percussions et des chorégraphies locales, chacun habillé en costume traditionnel. Autour du stade, c’est tout autant l’effervescence, avec des écrans géants pour ceux qui n’ont pas eu accès aux 6 000 places de la salle — soit car le lieu était complet, soit à cause du coût des billets, qui reste important pour une population aux ressources limitées.
Des petites échoppes de nourriture de rue sont alignées les unes derrière les autres, et proposent les délices locaux, bien épicés. Des familles entières viennent déposer leurs affaires, des heures durant, et regardent, assises à même le sol, les exploits des uns et des autres — avec un chauvinisme assumé ! Curiosité locale : c’est ici, en Indonésie, que l’on peut entendre un fan, ou plusieurs, lancer une exclamation lorsqu’un joueur manque un volant… C’est « bon enfant », et réputé — cela fait même rire les principaux intéressés, qui ont bien compris le côté « taquin » des fans locaux. La presse, quant à elle, suit avec intérêt cet évènement : ce sont régulièrement 200 à 300 médias locaux qui se font accréditer.
« On y chante, on y danse, les spectateurs font tellement de bruit qu’on ne s’entend même pas entre nous sur le court. »
Le badminton, un outil d’insertion sociale
Devenir un champion, c’est le rêve de tout un peuple. Y compris dans les familles défavorisées, pour lesquelles le badminton peut représenter un véritable ascenseur social — d’anciens champions, comme Rexy Mainaky, viennent d’un milieu extrêmement modeste. C’est d’ailleurs lui, le « Zidane » local, qui est récemment allé dans une déchèterie municipale, où un village s’est construit, peuplé de familles d’éboueurs — y compris des enfants — à la recherche de plastique à recycler. Il y a rencontré des parents dans le cadre d’un programme porté par la fondation Yayasan Bintang Kidul, en partenariat avec l’association française Solibad – Badminton sans frontières. À ses interlocuteurs sidérés de le voir débarquer chez eux, dans leurs maisons en tôle au milieu des détritus, il a raconté comment il avait quitté son foyer familial pour celui d’un parent éloigné, dû marcher deux heures tous les jours pour aller aux entraînements de l’équipe nationale. Tout cela pour les encourager à laisser leurs enfants participer à ce programme caritatif.
Depuis dix ans, Solibad et Bintang Kidul parcourent le pays et proposent aux jeunes les plus défavorisés de rejoindre des cours de badminton, avec des leçons axées sur la valorisation et l’estime de soi, mais également, pour certains d’entre eux, de se voir offrir une bourse d’études supérieures à Yogyakarta. Depuis le début du programme, deux jeunes ont reçu leur diplôme d’entraîneur et sont partis vivre au Canada, devenant responsables de clubs reconnus — ce qui leur permet d’aider financièrement leurs familles restées dans la déchèterie. Un autre vient d’obtenir son diplôme d’avocat. Le badminton, c’est aussi ça en Indonésie : un tremplin social extraordinaire…