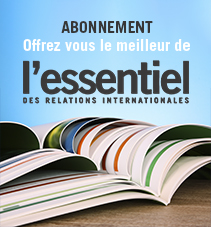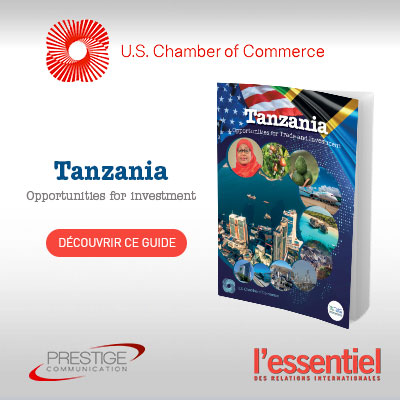Dans un monde fragmenté et en proie à de nombreux conflits géopolitiques, l’Europe est une zone stratégique mais également singulière. Territoire historiquement sujet aux alliances diplomatiques, économiques et culturelles multiples, elle doit faire face aux blocs américain et chinois tout en gardant une voix forte et crédible. Face à ces puissances que tout oppose, l’Europe a-t-elle encore les moyens d’imposer sa voix, ou n’a-t-elle plus qu’à choisir son camp ?
Par Noémie Masbou
Au cœur de la mondialisation effrénée du XXIe siècle, la rivalité sino-américaine a pris de l’ampleur sur le plan économique — mais pas seulement. De façon souvent détournée, en évitant une confrontation brutale, leurs relations conditionnent l’autonomie stratégique du continent européen. La souveraineté est plus que jamais au centre des préoccupations de ce dernier, et ses marges de manœuvre économiques ou sa capacité à défendre un ordre international fondé sur des règles deviennent cruciales. À l’heure où les crises s’enchaînent, les États européens cherchent à parler d’une voix commune.
Ce contenu est réservé aux abonnés
Le fonctionnement de l’Europe et sa stratégie diplomatique mondiale
L’Europe politique est souvent confondue avec l’Union européenne, née d’un pari diplomatique qui était de faire de l’interdépendance économique un instrument de paix. L’idée de se rassembler en communauté n’a cessé d’évoluer après la Seconde Guerre mondiale, en commençant par la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), puis le marché unique et enfin le Traité de Lisbonne. L’UE a imaginé des accords qui créent des règles afin de contourner l’usage de la force brute. Cette union large et de plus en plus puissante a structuré sa diplomatie autour d’un cœur institutionnel (Conseil, Commission, Service européen pour l’action extérieure) et d’un principe fondateur qui exige l’unanimité pour les décisions les plus sensibles. Cette communauté, bien qu’imparfaite, est la plus solide jamais imaginée et transcende souvent les voix étatiques. Sa diplomatie, qui se veut légitime et prévisible, souffre parfois de lenteur et d’un manque d’action car il existe une inertie non négligeable lorsqu’il faut emporter l’adhésion de 27 interlocuteurs.
L’UE est une négociatrice redoutée pour sa politique commerciale et a imposé des standards puissants en matière de concurrence. Les normes qu’elle fixe influencent les pratiques globales, notamment sur les sujets climatique et numérique où elle a mis en place des repères désormais considérés comme une base d’action mondiale. Ce qui fait sa force est aussi sa faiblesse : la puissance règlementaire permet stabilité et consensus, mais est génératrice de lenteur et de lourdeur administrative. L’UE prend le temps de réfléchir et de se mettre d’accord en interne quand d’autres acteurs privilégient l’outil coercitif ou la diplomatie du rapport de force.
Sur le plan géopolitique, l’UE s’est projetée par élargissements successifs et politiques de voisinage et a pu mettre en place une diplomatie de stabilisation. Elle a développé des prérequis de financements, des conditionnalités morales et une assistance institutionnelle pour permettre l’accès à la communauté pour les pays qui souhaiteraient la rejoindre. Bien que l’union fasse la force, l’unité est fragile dès que les intérêts divergent. Tous les pays membres de l’UE n’ont, par exemple, pas la même exposition commerciale à la Chine. La perception de la menace russe diffère entre Baltique et Méditerranée. La relation transatlantique n’a pas le même poids à Paris et à Varsovie. De ces constats naît une tension permanente entre l’ambition d’une autonomie stratégique et la réalité d’une dépendance sécuritaire assumée au sein de l’OTAN. Malgré tous ses outils et ses atouts internes, l’UE est-elle vraiment indépendante et de taille à rivaliser avec la Chine et les États-Unis, auxquels elle entend se mesurer ?
Les dépendances historiques et contemporaines de l’UE à la Chine et aux États-Unis
En Europe, la diplomatie américaine s’inscrit dans le long terme et a vu la création d’alliances diverses pour l’ensemble des préoccupations transatlantiques. Elle est à l’initiative de l’architecture de sécurité au travers de l’OTAN, d’institutions économiques majeures (Accords de Bretton Woods, GATT/OMC), et d’un plan commun pour la dissuasion nucléaire et la projection de puissance. Après 1945, les États-Unis, renforcés par la victoire en Europe, pensent l’ordre international à leur avantage. Pendant la guerre froide, la doctrine d’endiguement organise le monde en blocs. L’Europe, naturellement, jure fidélité à Washington. Après 1991, l’instant unipolaire confirme la centralité américaine, victorieuse et modèle de démocratie stable et puissante.
Aujourd’hui, la rivalité avec la Chine structure la politique étrangère des États-Unis. Elle dépasse les clivages de l’alternance politique et cristallise l’attention sur de nombreux sujets centraux. Washington veut sécuriser ses chaînes d’approvisionnement, garder la mainmise sur les technologies critiques, conserver le contrôle des exportations, et pouvoir agiter la menace de sanctions financières lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Le dollar américain et la bourse de Wall Street restent des instruments d’influence mondiaux, et le réseau d’alliances américain demeure sans équivalent. Pour pérenniser ce statut, les États-Unis demandent davantage de leurs partenaires européens, notamment de renforcer leurs investissements dans le domaine de la défense et de partager la politique américaine sur les lignes rouges technologiques. C’est une alliance historique entre les États-Unis et l’Europe, mais négociée en permanence.
La trajectoire chinoise quant à elle combine réformes économiques, maturité industrielle et affirmation politique. Depuis son ouverture à la fin des années 1970, puis son accès à l’OMC et ses politiques industrielles massives, elle a gagné sa place de puissance et imprimé mondialement son statut de force économique incontournable. Dans la lignée des dynamiques historiques créées lors de la première mondialisation au XVIIe siècle, Pékin bâtit activement sa diplomatie des infrastructures et des ressources. Les « nouvelles routes de la soie » terrestres et maritimes tissent une toile reliant la Chine à l’Europe via toutes les infrastructures de communication modernes. Dans les enceintes multilatérales, la Chine gagne en influence et se distingue des États-Unis en promouvant un développement sans conditions politiques, sans prérequis de moralité partagé, et se présente comme le porte-parole de l’Asie.
L’Europe est très sensible aux propositions de la Chine qui apparaissent souvent plus terre à terre. Cependant les liens culturels et moraux sont plus distendus et sources d’incompréhensions qu’avec les États-Unis, puisque le soft power américain nous a largement influencés depuis la création de l’UE. La présence diplomatique chinoise s’accompagne d’une plus grande assertivité au regard de la souveraineté territoriale, pose des questions sur la sécurité des données et challenge l’Europe quant à sa politique technologique. Pour les Européens, la Chine est à la fois un partenaire mais surtout un concurrent et rival systémique. Ses positions diplomatiques plus clémentes vis-à-vis de la Russie ou de la Corée du Nord sont mal acceptées par ces alliés des États-Unis, qui ne se sentent pas soutenus dans leurs positions stratégiques. C’est ici que la voie européenne hésite entre coopération climatique et fermeté commerciale, entre condamnation diplomatique et maintien du dialogue politique.
Les instances de la diplomatie, lieux de réunions inégales pour l’entité « Europe »
En matière de diplomatie mondiale, l’ONU incarne la légitimité internationale et ses impasses. Le Conseil de sécurité onusien est à la fois une tribune et un verrou car les vétos croisés bloquent les résolutions les plus décisives. Pourtant l’ONU demeure l’infrastructure de la paix, de l’humanitaire et du droit, et reste la seule vraie instance de dialogue pour l’ensemble des pays dans le monde. L’Europe, forte de ses contributions financières et de son attachement au multilatéralisme, y trouve un intérêt naturel. Attachée à ses valeurs et à son cadre normatif, elle y défend la charte, le droit international humanitaire, les sanctions encadrées et le rôle des agences onusiennes. En revanche, à l’instar de sa propre organisation communautaire, l’UE y mesure aussi ses limites car sans pouvoirs régaliens unifiés, elle ne peut dépasser la contrainte des vétos des membres permanents du Conseil de sécurité.
L’institution phare pour la sécurité européenne est l’OTAN, qui depuis sa création joue le rôle de filet de sécurité du continent. Elle vient en soutien de la construction de l’UE et scelle une défense mutuelle de part et d’autre de l’Atlantique, avec les États-Unis, d’abord contre la Russie mais également contre quiconque à l’Est voudrait s’en prendre à l’Europe. Au-delà de la clause de défense collective, l’Alliance est un écosystème d’interopérabilité, de planification et de partage de renseignements. Pour l’Europe, c’est à la fois une assurance-vie et une dépendance de fait puisqu’elle met entre les mains des Américains son autonomie opérationnelle. Les Européens essaient de se détacher de cette conditionnalité en investissant dans leur propre défense, sur les plans nationaux et par le biais de l’UE. Mais le retard accumulé en termes de munitions, de mobilité militaire, de défense aérienne et dans le domaine spatial est considérable. L’OTAN est et reste incontournable. Cependant, dans le contexte actuel de regain des tensions, et se trouvant au cœur d’une rivalité sino-américaine grandissante, l’UE entend s’en détacher partiellement et ses États membres veulent reprendre à leur compte la capacité d’action stratégique de défense.
Au-delà de l’ONU et de l’OTAN, d’autres instances internationales se prêtent à des discussions diplomatiques et stratégiques. Le G7 fixe les lignes des démocraties industrielles, le G20 élargit la discussion aux économies émergentes et les COP sont devenues des moments politiques autant que techniques, où l’Europe déroule les objectifs de sa diplomatie verte. L’OMC, bien que fragilisée, essaie de conserver le leadership de référent des règles commerciales où l’UE défend la modernisation de l’arbitrage et la lutte contre les distorsions. Ces forums, informels et non contraignants, n’en sont pas moins stratégiques car plus thématiques, et permettent des discussions plus courageuses qu’au sein de l’ONU par exemple.
Des voix plurielles en Europe face aux enjeux et conflits actuels
La guerre en Ukraine est un révélateur et a permis de démontrer ce que l’Europe sait faire, mais elle a aussi testé son unité. Pour l’heure, face à la menace russe d’une annexion territoriale, l’ensemble des pays se sont entendus sur une ligne commune, à la fois déclarative et en matière de sanctions économiques et diplomatiques ainsi que d’aide militaire. La Chine a, elle, adopté une posture prudente sur le plan diplomatique en usant de discours de neutralité et en faisant plusieurs propositions de cessez-le-feu. Elle a en revanche continué son commerce soutenu avec Moscou et un soutien technologique dual parfois ambigu. Pour l’Europe, l’équation en Ukraine est double : elle consiste à tenir la ligne du droit international avec les États-Unis et de la sécurité du continent, tout en préservant une capacité de dialogue avec la Chine pour éviter une cristallisation en blocs que tout oppose. La voix diplomatique européenne est audible lorsqu’elle articule principes moraux, soutien concret économique et militaire, et vision d’un horizon politique. Elle s’affaiblit lorsqu’elle se divise sur la stratégie à long terme vis-à-vis de la Russie ou lorsque les États-Unis changent le cap qu’ils avaient fixé initialement.
Au Proche-Orient, les États-Unis restent l’interlocuteur militaire décisif et le médiateur incontournable. La Chine s’y installe patiemment et discrètement, via l’énergie, les infrastructures et quelques gestes diplomatiques symboliques, mais n’intervient pas sur le devant de la scène pour des négociations. L’UE parle souvent à plusieurs voix, les États agissent d’abord de leur côté avant de trouver une position commune. La France et le Royaume-Uni apparaissent plus écoutés que l’UE car membres du Conseil permanent de l’ONU, et parce qu’ils sont des puissances diplomatiques et militaires historiques de premier plan. Là encore, la question n’est pas l’intention, mais la capacité à produire des effets politiques. La proposition de reconnaissance de l’État de la Palestine par la France a provoqué davantage d’effet que les nombreux appels au cessez-le-feu de l’UE. Jusque-là, les États-Unis et Israël semblaient organiser les négociations sur la situation avec Gaza sans l’Europe.
Sur les sujets brûlants, il semble que l’Europe soit désunie. Les États-nations supplantent encore une ligne communautaire et dictent la marche à suivre à l’échelle mondiale. Cet émiettement des interlocuteurs profite à la Chine et aux États-Unis qui apparaissent comme de grands blocs unis et non soumis à la collégialité de décisions. La première voix entendue en Europe n’est pas celle d’un consensus, mais celles de certains pays plus implantés que d’autres, la voix commune étant plus longue à être formulée.
Une puissance à entretenir et une singularité à développer
L’Europe, si elle est envisagée comme une entité historique partageant des similitudes, n’a pas vocation à choisir un camp contre l’autre. Elle est l’alliée des États-Unis par nécessité stratégique et communauté de valeurs, et le partenaire de la Chine par réalisme économique et responsabilité globale. Entre ces deux puissances, l’Europe pourrait incarner un pôle d’équilibre promouvant une diplomatie ancestrale et réglementée.
La communauté formée par l’UE pourrait parvenir à se créer une place prépondérante sur la scène internationale en matière de diplomatie, mais pour cela, elle doit protéger son modèle et sa singularité. L’actualité mondiale l’a montré, elle doit investir dans ses outils et dans ses capacités d’action, à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan opérationnel. Elle doit ensuite améliorer sa coalition politique et trouver une voix plus unie, en cessant de déléguer ses déclarations à certains de ses pays membres les mieux dotés.
La voix européenne ne gagnera en portée que si elle présente sa propre diplomatie incarnée. À condition d’aligner ses intérêts, ses instruments et ses ambitions en interne, et d’accepter que, pour être entendue, une voix doit être unique et incontestée.