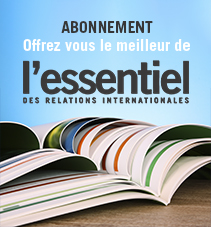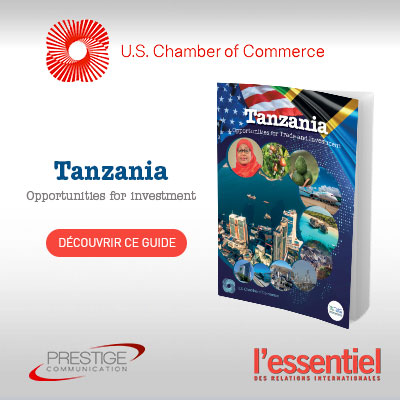À l’issue du second mandat d’Emmanuel Macron, un nouveau président sera élu. Face à l’enjeu de la refonte des forces politiques en présence, comment s’en sortira la droite républicaine ? Quel candidat pourra tirer son épingle du jeu ?
Par Maguy Camélinat
À deux ans de l’échéance présidentielle de 2027, la droite française semble plus dispersée que jamais. Le parti historique, Les Républicains (LR), ne parvient pas à imposer une figure incontestée qui rassemble ses électeurs face à l’électorat grandissant du Rassemblement national (RN). Autour de lui gravitent des candidats déclarés, des ambitions en coulisse et d’anciens visages revenus sur le devant de la scène. Ce morcellement illustre une droite en quête de ligne politique, de leadership et surtout d’unité dans un contexte national et international plus qu’incertain à l’issue de l’ère Macron.
Ce contenu est réservé aux abonnés
Des candidats multiples et des liens variables avec LR
Le candidat le plus en vue, car membre du Gouvernement et adoubé par le LR, serait Bruno Retailleau. L’actuel président du groupe LR au Sénat et chef du parti depuis début 2025 est un conservateur assumé qui se place sur une ligne d’autorité républicaine. Sa position ferme sur l’immigration, démontrée au sein du Gouvernement Bayrou, et son idéologie libérale sur le plan économique en font un candidat évident pour les LR. Il souhaite ramener la droite à « ses fondamentaux », selon ses dires. Reste à savoir s’il saura gagner l’adhésion des militants et des électeurs de droite.
De son côté, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône‑Alpes, n’a pas encore fait part de ses intentions pour 2027 mais est toujours considéré comme un possible recours pour les LR. Contrairement à Bruno Retailleau, il privilégie le travail local et reste à distance du débat national. Pourtant, son ancrage au sein du parti et ses positions politiques ni timorées ni extrêmes en font un prétendant solide, qui rassemble une vaste majorité des LR. Mais il n’est pas sûr que le parti le soutiendrait face à Bruno Retailleau. Il pourrait jouer la montre, à l’inverse d’autres personnalités déjà engagées dans la course, avec d’éventuelles primaires à droite, et se poser en candidat porteur d’unité.
C’est le cas de Xavier Bertrand, qui a rompu avec LR depuis la précédente élection présidentielle. Après un échec retentissant à la primaire de 2021, il a fondé le mouvement Nous France, une structure plus personnelle qui lui permet de défendre une droite sociale, républicaine et attachée à la décentralisation. Il a développé son ancrage territorial et des idées de droite plus centristes. Il est un candidat affirmé pour l’élection de 2027. Il refuse toute porosité avec le RN, et se pose comme l’homme du « territoire » qui pourrait entraver l’engouement suscité par ce parti aux précédentes élections législatives de 2024, à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron.
Une autre candidature alternative d’ores et déjà déclarée est celle de David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des maires de France (AMF). Il incarne une droite libérale, locale et régalienne. Tout en restant membre des LR, il a fondé son propre mouvement, Nouvelle Énergie (NE), et appelé à l’organisation d’une primaire à droite pour désigner le candidat qui se présentera à l’élection. Rien ne permet de savoir s’il participerait à cette primaire, ni s’il renoncerait à se présenter s’il n’était pas élu et porté par les membres du parti. Sa stratégie est d’imposer un projet politique avant de s’imposer lui-même, tout en mettant en avant se connaissance du terrain et ses soutiens politiques nombreux. Il est en revanche pour l’heure très peu connu du grand public. Son positionnement représente une tentative de renouvellement de la droite française, en rupture avec les partis traditionnels, et pourrait influencer le paysage politique à venir.
L’une des candidatures les plus attendues par les observateurs est celle d’Édouard Philippe, ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron au cours de son premier mandat présidentiel. L’ancien membre des LR, qui a quitté son parti dès sa nomination au Gouvernement en 2017, est depuis 2021 président du parti Horizons (HOR). Il se présente comme un homme de droite, gaulliste, libéral et modéré, et souhaite incarner le rassemblement au-delà des clivages traditionnels droite-gauche, à l’instar de son mentor Emmanuel Macron. Il a officiellement déclaré sa candidature dès 2024, et se tient distant des querelles médiatiques partisanes tout en captant l’électorat de droite centriste.
Dominique de Villepin, le comeback de l’outsider
Ancien ténor de la droite traditionnelle — l’UMP en son temps —, Dominique de Villepin est récemment revenu sur le devant de la scène politique française. Considéré comme expert en relations internationales en raison de ses divers mandats politiques, notamment celui exercé en tant que Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères dans le Gouvernement de cohabitation de Jean-Pierre Raffarin, il est resté dans les esprits comme une voix forte en faveur de l’indépendance française.
Cet ex-Premier ministre de Jacques Chirac a opéré un retour médiatique notable pour décrypter les situations conflictuelles mondiales qui agitent l’actualité, et s’est repositionné comme personnalité gaulliste, humaniste et internationaliste. Fort de son succès, il a créé en 2025 le parti La France humaniste. Il ne revendique pas une étiquette LR et n’a pas annoncé d’ambition présidentielle pour l’heure, mais il incarne un héritage historique prestigieux qui pourrait supplanter les querelles de partis et les clivages politiques actuels. Il privilégie une vision diplomatique et civilisationnelle de la France, ce qui est rare dans le paysage électoral.
Figures médiatiques vs ancrage local
L’objectif de tous pour la prochaine élection sera de rassembler la droite, de retrouver l’unité portée jadis par le RPR et d’emporter l’adhésion populaire. Si l’ensemble de ces candidats issus de la droite partagent souvent les mêmes électeurs potentiels, leur poids et leur présence dans les médias sont très variables, et leur implantation politique et/ou leur ancrage local varie considérablement.
Édouard Philippe et Dominique de Villepin dominent en 2025 les sondages de popularité. Le premier est plébiscité pour sa gestion, à l’époque jugée responsable, à Matignon, et son positionnement modéré, pragmatique, alliant rigueur budgétaire et réformes structurelles, gestion efficace des crises nationales, et capacité à maintenir le dialogue tout en imposant l’autorité, notamment lors de la crise des « gilets jaunes ». Le second est apprécié pour la force de ses prises de parole sur la scène internationale, notamment au sujet de la guerre en Irak lors de son célèbre discours à l’ONU s’opposant à l’intervention militaire, ou sur le conflit au Proche-Orient où il a souligné la nécessité d’une solution à deux États, avec la reconnaissance d’un État palestinien aux côtés d’Israël. Cependant, leur visibilité médiatique ne compense pas une faible implantation locale : ni Dominique de Villepin ni Édouard Philippe ne disposent de réseaux territoriaux aussi denses que ceux de Xavier Bertrand ou David Lisnard. Ils peinent donc à obtenir les soutiens des grands électeurs ou des forces décisionnaires des appareils partisans. Cependant, le parti HOR d’Édouard Philippe a su se développer dans les assemblées en soutenant des candidats aux élections législatives de 2022. En 2024, le mouvement a marqué une rupture avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe critiquant la dissolution de l’Assemblée nationale et appelant à une nouvelle majorité politique. Le groupe Horizons & Indépendants est actuellement composé de 34 députés à l’Assemblée nationale et compte 18 sénateurs, ce qui en fait une force politique influente dans le paysage national.
De l’autre côté de cet échiquier politique de droite, Xavier Bertrand s’appuie sur une base régionale solide, en particulier dans les Hauts-de-France. Sa stature de « président de région engagé » lui permet de maintenir un socle fidèle qui brille aux élections régionales, bien que ses performances dans les sondages restent moyennes. Ses actions sont concrètes, elles légitiment son discours et rassurent ses soutiens. Il est connu de l’opinion publique assez largement en France, même s’il n’est pas plébiscité au niveau national comme dans son fief du nord de la France.
David Lisnard, personnalité plutôt locale, cultive sa popularité chez les maires et les élus locaux. Très peu connu du grand public, il est très actif dans les médias spécialisés et sur les forums territoriaux. Son réseau professionnel lui assure des soutiens stables mais il lui reste encore à faire émerger son programme et sa personnalité aux yeux des électeurs français.
Membre de l’actuel Gouvernement de François Bayrou, Bruno Retailleau dispose du soutien de son parti mais commence seulement à se faire connaître du grand public. Son discours ferme sur l’autorité et les valeurs républicaines font écho à droite et s’éloigne de celui du Président Emmanuel Macron. Il séduit une frange conservatrice, mais sa visibilité comme candidat présidentiable reste à construire.
Une autre figure médiatique du paysage LR et connue dans l’opinion publique est Laurent Wauquiez. Son retrait prolongé des discussions politiques interroge sur son statut d’actuel ou d’ancien poids lourd du parti. Il bénéficie encore d’une notoriété importante, mais son échec à la primaire de 2021 et les polémiques au cours de son mandat de président des LR laissent une partie des militants sceptiques quant à ses chances de retour, et plus largement sur son potentiel électorat à la prochaine élection présidentielle.
Relever les défis en 2027 et contrer la montée des extrêmes
Les défis qui s’annoncent pour 2027 sont considérables, mais en premier plan la succession de l’ère Macron interroge. Comment réorganiser une classe politique plus divisée que jamais depuis que l’actuel Président a fait voler en éclats le clivage gauche-droite traditionnel ? La droite entend se positionner pour répondre à la menace du RN, qui progresse sur la scène politique française, et pour faire face à l’actuelle crise démocratique et au sentiment de perte de repères idéologiques. À cela, chacune des personnalités de la droite évoquées précédemment propose une réponse différente.
En matière de priorités politiques, les candidats oscillent entre enjeux macroéconomiques et préoccupations singulières et d’ordre symbolique. Édouard Philippe et Bruno Retailleau privilégient une approche d’abord centrée sur une politique intérieure forte, mettant en avant les sujets économiques, sécuritaires et institutionnels. Pour Bruno Retailleau, le combat est culturel et civilisationnel, et il voit 2027 comme l’occasion d’un recentrage sur « l’autorité, la transmission et l’identité française ». Édouard Philippe se positionne comme le candidat du « sérieux », prêt à prolonger une partie du macronisme tout en se démarquant par une méthode plus consensuelle via une « réconciliation démocratique », en misant sur la réforme de l’État et la stabilité. Dans la même logique, Laurent Wauquiez, appelle à réconcilier souveraineté et efficacité publique, pour retrouver un État fort.
Face à cela, David Lisnard et Xavier Bertrand, enracinés dans la gestion locale, insistent sur les problèmes concrets des Français, comme les services publics, la fiscalité ou la mobilité. Leur discours remet au cœur du fonctionnement de l’action politique la proximité et le pragmatisme territorial. Ils veulent rétablir les services publics, restaurer la sécurité et renouer avec les classes moyennes. Les actions dites concrètes et factuellement évaluables par les Français sont au cœur de leurs projets. Ils partent du particulier pour créer une cohésion nationale, plutôt que d’essayer de rencontrer l’unité par des mesures venant d’un pouvoir centralisé déconnecté des territoires.
Mais tous ces candidats se heurtent à une incertitude : quelle sera la place de la droite modérée, qu’ils souhaitent incarner, à la prochaine élection présidentielle ? Cette interrogation provient en grande partie de l’inconnue que représente le RN, en forte progression depuis le second mandat du Président Macron. L’absence d’unité à droite pourrait leur coûter très cher face à une extrême droite plus audible et décomplexée que jamais. L’unité retrouvée du RN et sa gestion jugée pragmatique à l’Assemblée nationale pourrait continuer d’affaiblir les LR dont l’unité peine à être restaurée depuis l’échec retentissant de François Fillon à l’élection présidentielle de 2017. Une nouvelle primaire n’a pas encore été décidée par les LR qui pondèrent la pertinence de cet exercice face aux précédents déboires de 2017 et 2022. Le rassemblement de la droite n’a pas été au rendez-vous lors des précédentes échéances électorales nationales et les candidats cherchent à endiguer, chacun avec leur propositions, ce phénomène. Par ailleurs, l’ensemble de ces candidats, Xavier Bertrand, David Lisnard, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez et Dominique De Villepin, pourraient bien être surpris par l’arrivée d’une nouvelle candidature inattendue. L’objectif est de concentrer l’attention des médias, des soutiens politiques, mais surtout des électeurs pour unir l’ensemble des sensibilités de droite afin d’avoir des chances de remporter l’échéance des élections présidentielles de 2027.
Gabriel Attal pour l’après-Macron
Alors que s’achève le second quinquennat d’Emmanuel Macron, la question de sa succession anime déjà les rangs de Renaissance. Le chef de l’État a bâti son pouvoir en s’appuyant largement sur des alliances avec le centre droit et avec des figures des Républicains, bien davantage qu’avec la gauche socialiste. Dans ce paysage, Gabriel Attal s’impose comme un membre de la première heure et dont la popularité, même après son passage éphémère à Matignon, reste élevée et nourrit son ambition. Il a l’intention de marcher dans les pas de son mentor mais il doit encore asseoir son autorité dans son propre camp et affirmer une vision politique lisible. Ses déclarations jugées alternantes interrogent, car, libéral en économie, il défend aussi des mesures sociales qui brouillent son message, tant chez les centristes qu’à droite. Cette ambivalence est redoutée, notamment par Édouard Philippe et par les candidats de la droite les plus au centre, qui appréhendent l’émergence d’une nouvelle candidature « à la Macron », capable de séduire leur électorat hésitant.