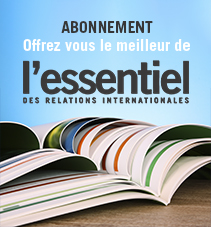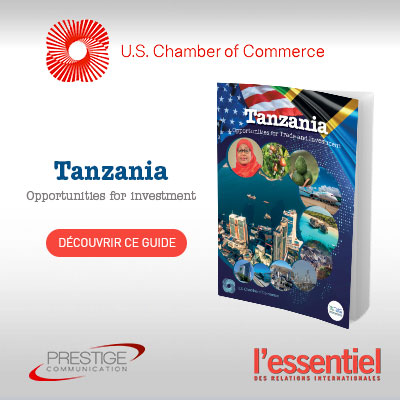Alors que l’Indonésie monte en puissance diplomatiquement et économiquement, le rôle des leaders religieux pour favoriser l’unité et le dialogue progressiste n’a jamais été aussi vital. En première ligne se trouve le Ministre Nasaruddin Umar, un éminent érudit, Grand Imam de la mosquée Istiqlal et défenseur bien connu de l’interconfessionnalisme, dont le parcours universitaire s’est déroulé dans les meilleures institutions du monde, y compris aux États-Unis avec des études sur le judaïsme. Depuis sa prise de fonctions en octobre 2024, il a guidé la politique religieuse du pays avec empathie et rigueur, s’engageant fermement en faveur du pluralisme. Son leadership annonce un nouveau chapitre de la gouvernance de la foi, vers encore plus d’inclusivité, dans une nation en pleine évolution, une nation de plus en plus considérée comme un modèle international de coexistence interconfessionnelle pacifique.
Par Feliana Citradewi
Lorsque sa photographie emblématique — celle où on le voit baiser le front du Pape François à l’intérieur de la plus grande mosquée d’Indonésie — attira l’attention du monde entier, Nasaruddin Umar devint un symbole de respect et de dialogue interconfessionnel. Ministre des Affaires religieuses d’Indonésie depuis 2024, il apporte son érudition et son leadership à l’une des institutions les plus importantes de la nation. Grand Imam de la mosquée Istiqlal, il est largement reconnu pour son engagement en faveur du pluralisme, de l’autonomisation des femmes dans l’islam, et de la promotion de l’harmonie tant religieuse qu’avec la nature.
Ce contenu est réservé aux abonnés
Avant d’obtenir ce poste, Nasaruddin Umar était Vice-Ministre des Affaires religieuses (de 2011 à 2014), et s’est imposé comme un universitaire respecté. Il a obtenu son doctorat à l’IAIN Syarif Hidayatullah avant de poursuivre ses études à McGill, Leiden et la Sorbonne. Avec une carrière couvrant l’enseignement, le dialogue interconfessionnel et la diplomatie mondiale, il incarne la voix de « l’islam modéré » indonésien, faisant du pays un exemple de tolérance et d’inclusivité sur la scène mondiale.
La mosquée Istiqlal — la plus grande d’Asie du Sud-Est — se dresse au centre de Jakarta ; des milliers de fidèles se rassemblent sous son imposant dôme pour les prières du vendredi. Mais ce qui rend l’ambiance de la ville exclusivement indonésienne n’est pas tant l’envergure du culte que ce qui se passe hors des murs de la mosquée : chrétiens, hindous, bouddhistes et musulmans travaillent côte à côte dans les bureaux du Gouvernement, célébrant ensemble l’indépendance du pays, et partageant leurs repas au-delà des clivages religieux. Ceci est l’accomplissement remarquable de l’Indonésie, une nation qui a réalisé ce qui est peut-être le modèle le plus réussi d’harmonie religieuse et de diversité.
L’architecte de la diplomatie religieuse moderne
Nasaruddin Umar incarne cette approche indonésienne unique de la foi et de la gouvernance. Connu pour ses vues modérées et ses concepts théologiques innovants, il a passé des décennies à développer l’écothéologie, un cadre révolutionnaire qui cherche à transformer la manière dont les religions s’articulent entre elles et dans le monde.
« Nous ne pouvons pas créer l’harmonie uniquement par la logique formelle, simplement en créant des lois sur la tolérance, explique le Ministre. Nous devons faire quelque chose de plus fondamental. Nous avons instauré ce que nous appelons le “Curriculum of love” [Curriculum de l’amour] et l’écothéologie, une théologie féminine qui transforme notre compréhension du divin. »
Au-delà du sécularisme : la troisième voie indonésienne
L’approche indonésienne défie les catégories occidentales, qui opposent sécularisme et théocratie. Avec la population musulmane la plus nombreuse au monde — plus de 230 millions de fidèles —, le pays n’a choisi ni la voie d’un État islamique, ni celle de l’exclusion de la foi dans la vie publique. Il a développé ce que l’on pourrait appeler une « gouvernance religieuse inclusive ».
« Dans le Coran, il n’y a pas de terme pour « majorité » ou « minorité », note Nasaruddin Umar. Notre Constitution, nos lois… aucune ne contient ces notions. Ce que dit le Coran est : « Prendre une vie est comme prendre toutes les vies. Sauver une vie est comme sauver toutes les vies. » »
Cette philosophie imprègne la structure de gouvernance de l’Indonésie. Le ministère des Affaires religieuses lui-même, une institution qui serait controversée dans des États strictement séculaires, gère non seulement les affaires de l’islam, mais aussi de toutes les religions reconnues, toutes également traitées et représentées.
La révolution de l’écothéologie
Ce qui est peut-être la contribution la plus importante du Ministre Umar à la pensée religieuse mondiale est son développement du concept d’écothéologie, qu’il décrit comme « un système théologique qui réunit l’humanité, l’environnement, la nature et Dieu ». Il a sur cette question attiré l’attention internationale, avec des invitations arrivant d’universités d’Amérique, du Pakistan, d’Abou Dabi, du Qatar et de Malaisie. « L’écothéologie nous apprend que « Tat tvam asi » — tu es moi, je suis toi, explique-t-il, s’inspirant de la sagesse ancestrale sanskrite. Quand je détruis la nature, je me détruis. Quand j’embellis mon environnement, je m’embellis. Cela s’applique non seulement aux humains, mais aussi aux animaux, plantes et à toute la création. »
Cette philosophie s’étend bien au-delà des questions environnementales, et va jusqu’à l’harmonie sociale. « Pourquoi y a-t-il tant de crimes et de violence dans la société ? Parce qu’il n’y a plus dans nos environnements des aires de jeux, des fleurs, des arbres qui donnent de la fraîcheur, le son des chants d’oiseaux. Quand nous détruisons la beauté naturelle, nos cœurs deviennent secs, nos esprits étroits. »
Le Curriculum of love en pratique
Le système d’éducation religieuse indonésien reflète cette approche inclusive à travers le Curriculum of love. De la maternelle à l’université, l’instruction religieuse met l’accent sur les points communs plutôt que sur les différences.
« Nous sommes convaincus que mieux nous comprenons nos religions respectives, plus il est difficile de trouver des différences entre une religion et une autre, explique le Ministre des Affaires religieuses. Mais si notre compréhension de notre religion est superficielle, il est facile de trouver des différences et même de déclencher des conflits. »
Cette philosophie de l’éducation a produit de remarquables résultats pratiques. En 2017, à la mosquée Istiqlal, l’Indonésie a tenu une cérémonie d’indépendance interconfessionnelle à laquelle les chefs de toutes les religions ont participé en portant leur tenue religieuse traditionnelle et en hissant ensemble le drapeau indonésien, un évènement qui, selon Nasaruddin Umar, n’a d’égal dans aucun pays.
La démocratie démographique en action
Gérer la diversité religieuse dans une nation de plus de 17 500 îles et 284 millions d’habitants demande de l’innovation institutionnelle. Le système démocratique décentralisé de l’Indonésie assure que les minorités religieuses aient une voix et soient représentées au niveau local, et le Gouvernement est le gardien des principes fondamentaux d’unité.
« Nous avons des camps interconfessionnels auxquels toutes les religions participent, campant ensemble, mangeant ensemble, discutant ensemble, vivant ensemble, détaille le Ministre Umar. Les différences religieuses doivent être regardées comme une extraordinaire richesse, comme une bénédiction, pas comme un désastre. »
Leadership mondial en diplomatie religieuse
Le succès de l’Indonésie dans sa gestion de la diversité religieuse en a fait un leader diplomatique mondial sur cette question. Le pays tient régulièrement des dialogues interconfessionnels et a été invité à partager son modèle avec d’autres nations qui connaissent des tensions religieuses.
« Nous sommes en train de développer ce que nous appelons « Ambassador Dialogues », en invitant des personnages importants de différents pays pour expliquer la diplomatie religieuse et présenter l’écothéologie. Si tous les pays adoptaient l’écothéologie, adieu la guerre, adieu les conflits. »
Le Ministre considère que la situation géographique de l’Indonésie et ses caractéristiques culturelles conviennent parfaitement à ce rôle de leadership. « L’Indonésie est comme un « morceau de ciel », géographiquement. Nous pouvons porter les mêmes vêtements toute l’année, notre soleil brille invariablement douze heures par jour. Nous sommes le pays le plus pluriel du monde mais également le plus sûr. »
Défis et orientations futures
Malgré son succès, l’harmonie religieuse indonésienne est confrontée à des défis contemporains. Mondialisation, réseaux sociaux et polarisation politique posent de nouveaux problèmes au modèle inclusif du pays. Nasaruddin Umar est conscient de ces défis mais demeure optimiste quant à la résilience de l’Indonésie. « La religion est comme l’énergie nucléaire. Elle peut devenir un générateur électrique très bon marché, mais elle peut aussi devenir une bombe destructrice. En Indonésie, nous nourrissons la religion comme on nourrit un bébé. »
Le Ministre cible particulièrement les citoyens de moins de 30 ans, estimant qu’« après 30 ans, il n’y a plus de révolution, plus d’agressivité » dans la manière de percevoir la religion. Cette approche axée sur la jeunesse vise à assurer la continuité de la culture religieuse modérée du pays.
Un exemple pour le monde
Alors que les tensions religieuses persistent dans le monde, de la Birmanie au Moyen-Orient, de l’Europe aux Amériques, l’exemple de l’Indonésie offre un espoir. Le pays a prouvé qu’une profonde foi religieuse et une démocratie pluraliste pouvaient non seulement coexister, mais aussi se renforcer mutuellement.
La vision de Nasaruddin Umar s’étend au-delà des frontières. « Le soleil se lève en Indonésie pour illuminer le monde entier, déclare-t-il avec la confiance qui le caractérise. Le Moyen-Orient a achevé sa tâche de répandre l’islam, mais quant au leadership futur de la civilisation islamique, il doit être centré en Indonésie. »
Que l’on accepte ou non cette volonté ambitieuse, le succès de l’archipel demeure indéniable : dans une ère de conflit religieux, il a créé un espace où la foi prospère, non pas malgré sa diversité, mais grâce à elle. Alors que le monde est aux prises avec l’augmentation des tensions religieuses, le modèle indonésien, imparfait mais inspirant, propose une nouvelle voie, où la mosquée et le temple, l’église et la salle de prière, peuvent constituer non pas un symbole de division, mais une capacité d’harmonie de l’humanité.
Nasaruddin Umar l’assure : « Nous sommes un, nous sommes pareils, des enfants d’Adam. Quand nous parlons des enfants d’Adam, il n’y a pas d’ethnie supérieure, pas de citoyens supérieurs, pas d’ethnicité là-dedans, pas de différence de couleur de peau, pas de différences culturelles, pas de différences religieuses. »
Cette vision, radicale dans sa défense de la paix et de la pluralité, profonde dans ses implications, est peut-être la plus importante contribution de l’Indonésie au XXIe siècle ; la preuve que dans notre monde fracturé, l’unité demeure possible. L’Indonésie en est un exemple vivant.