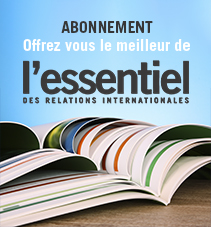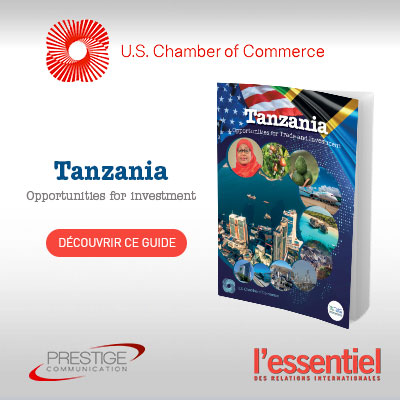Chef d’entreprise investi dans les zones franches, les ports maritimes et parcs logistiques privés, les télécommunications, les services financiers et la biotechnologie, Samuel Condé nous livre son analyse de l’évolution de l’économie dominicaine, et ses recommandations pour l’avenir.
L’évolution de l’économie dominicaine est notable. Le Financial Times a d’ailleurs publié un article mettant en lumière la formule du succès de la République dominicaine. « Notre économie est l’une des plus dynamiques d’Amérique latine, avec une croissance moyenne de 5,1 % au cours des 50 dernières années », précise Samuel Condé. Cette moyenne implique qu’il y a eu des années de faible croissance, mais aussi des périodes de forte expansion qui ont compensé. La croissance est exprimée en termes réels, c’est-à-dire en excluant les variations dues à l’inflation. « Dans l’ensemble, notre économie est dans une position forte et saine », confirme l’entrepreneur.
Ce contenu est réservé aux abonnés
Cependant, comme dans la plupart des pays en développement, il estime que la République dominicaine est confrontée « à un problème structurel lié à la qualité des dépenses publiques. L’utilisation des ressources par le Gouvernement présente des lacunes importantes qui doivent être corrigées ». Certains problèmes pourraient être résolus plus efficacement, selon lui. Un domaine crucial dans ce contexte est l’éducation, où Samuel Condé a travaillé intensivement, notamment bénévolement.
De grandes opportunités
La République dominicaine, malgré ces déficiences, dispose de grandes opportunités de développement. Samuel Condé considère certaines d’entre elles comme essentielles. « Lorsque j’étais président de l’organisation à but non lucratif Educa (Acción Empresarial por la Educación, ndlr), nous avons favorisé l’encadrement et l’amélioration du système éducatif », précise-t-il. Bien que depuis des années, 4 % du PIB soient alloués par la loi à l’éducation, notamment à l’enseignement préuniversitaire, les progrès réalisés en termes de qualité de l’apprentissage ne sont pas suffisamment significatifs. Ce qui est particulièrement préoccupant.
« Nous sommes une économie assez diversifiée. Nous avons le tourisme, l’industrie manufacturière, un système financier important, la construction, le commerce et l’agriculture. Nous avons un tourisme avec 10 millions de visiteurs. [Leur] consommation alimentaire [pourrait profiter de la] production nationale. Et pourtant, nous exportons […] des produits agricoles. Et il y a encore beaucoup à faire à cet égard. Mais de plus en plus de projets sont mis en ligne, des mises en œuvre majeures. » Malgré les défis, la République Dominicaine a un avenir qui n’est pas sombre, bien au contraire.
Connectivité…
L’aéroport de Punta Cana est le plus grand du pays, avec un flux annuel de près de 5 millions de passagers. Cela signifie un grand nombre de vols vers des destinations multiples. DP World, en collaboration avec Grupo Puntacana, développe un hub aérien, car la plupart des avions touristiques qui arrivent transportent des passagers avec peu de bagages, pour des séjours courts (une semaine ou quinze jours). Ces avions ont aussi la capacité de transporter du fret. En outre, Dubaï possède une compagnie aérienne majeure, Emirates, qui a transféré cette année ses opérations de Porto Rico vers la République dominicaine. Elle opère désormais directement à partir d’ici, se concentrant sur la logistique aérienne pour la région.
La clé de tout cela est la connectivité. « La République dominicaine est connectée au monde de manière très efficace. Caucedo est un port mondial et Punta Cana est un aéroport clé », rappelle Samuel Condé. Punta Cana gère environ 100 vols par jour et consomme dans les 130 millions de gallons de carburant par an, car de nombreux vols sont long-courriers, y compris des destinations en Europe et des vols directs vers la Russie.
… Et communications
Le pays, grâce à sa position géographique stratégique, est devenu un centre important du trafic de communications internationales. La majeure partie d’entre elles ne s’effectue pas par satellite, mais par des câbles sous-marins à fibres optiques qui traitent d’énormes volumes de données. « Actuellement, nous disposons de plusieurs points d’atterrissage pour les câbles sous-marins à Punta Cana, à Puerto Plata et dans le sud du pays. Tous ces points sont interconnectés avec le Caribbean NAP, situé dans le cyberparc, à proximité de l’aéroport et de Caucedo », détaille l’entrepreneur.
Ce NAP a commencé à servir principalement aux compagnies de téléphone, mais a évolué vers des opérations plus complexes, par exemple avec les centres de données pour des activités hautement sensibles comme la sécurité nationale, ou les banques qui, en raison des règlementations internationales, sont tenues de disposer d’un site miroir (data center de sauvegarde) en cas de sinistre ou d’attaque.
« Nous exploitons le NAP depuis 16 ans, offrant des services à des clients nationaux et internationaux. Un cas notable est celui de Telefónica de España, qui utilise nos services pour connecter ses opérations dans des pays comme la Colombie à son réseau mondial. Nous sommes également le lien local pour Starlink, transmettant les signaux de sa constellation de satellites », détaille Samuel Condé. La position géographique et les infrastructures développées ont permis à la République dominicaine de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. « Nous avons construit un écosystème diversifié qui comprend des centres de fabrication, des communications, du tourisme, des ports maritimes et des aéroports. »
L’Amérique latine, comme l’Afrique et l’Asie, attire un nombre croissant d’investissements internationaux. « Cependant, pour consolider ces relations économiques, il est essentiel de disposer d’acteurs économiques qui favorisent la connectivité et les échanges commerciaux. La volonté des gouvernements ou l’existence de l’offre et de la demande ne suffisent pas ; il est nécessaire que l’échange se déroule dans des conditions efficaces et compétitives », conclut l’entrepreneur.
Entretien avec Samuel Condé, Président-directeur général de Caucedo Development Corp.
Samuel Condé nous présente les grands atouts du port multimodal de Caucedo, dont le développement est primordial pour la République dominicaine.
Vous êtes un cofondateur du port multimodal de Caucedo, exploité par DubaiControls. Pouvez-vous nous présenter son histoire et son activité ?
Le port de Caucedo est entré en activité en 2004. Il a été développé sur des terrains privés, avec un financement privé, sans aucune garantie de l’État. Ce dernier nous a donné l’autorisation de le faire, mais sans plus. De plus, nous le payons : pour chaque conteneur qui entre sur le territoire national, il existe un CANA (Code additionnel national, qui précise les mesures douanières pour chaque produit, ndlr) que le Gouvernement facture à la collectivité locale.
Par rapport à l’investissement initial, le coût de ce projet a plus que doublé ces 20 dernières années. Il a commencé avec une dette privée de 200 millions de dollars. Notre investissement personnel ? Nous avons fait un groupe de gestion dominicain. J’ai dirigé ce groupe, avec deux autres promoteurs, les associés, et nous avons levé des capitaux. Cette dette de 200 millions représentait 70 % du total. Les 30 % restants, soit 100 millions, étaient constitués de capitaux en fonds propres que nous, investisseurs, avons investis.
Il s’agissait d’un consortium 50/50, initialement avec une société nord-américaine, une division du plus grand chemin de fer des États-Unis, CSX. CSX était à l’origine propriétaire de la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, SeaLand Service. Lorsque SeaLand a été vendu à Maersk, il restait un groupe de terminaux qui n’ont pas été vendus. CSX a créé une unité commerciale appelée CSX World Terminals, et c’était notre partenaire de développement.
En 2005, CSX a décidé de vendre ce groupe de terminaux. C’est à ce moment-là que la Dubai Ports Authority, connue à l’époque sous le nom de DPA, a racheté le groupe pour 1 milliard de dollars. Il s’agissait d’une douzaine de terminaux, qui marquaient l’entrée des ports de Dubaï sur le marché international. En 2006, Dubai Ports a racheté P&O Ports, s’imposant ainsi comme l’un des principaux opérateurs mondiaux.
Quel est l’impact de Caucedo dans la région ?
Caucedo a commencé comme un port de transbordement régional (Relay Cargo), desservant des routes entre la côte est des États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie. Aujourd’hui, Caucedo a la capacité de traiter 2,5 millions de conteneurs TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) par an. Nous en sommes à environ 1,7 million.
Lorsque les terminaux atteignent un niveau d’utilisation de 75 à 80 %, ils doivent s’agrandir. Nous sommes déjà dans la phase de développement technique de notre troisième extension. La dernière comprenait un poste d’amarrage de 17 m de profondeur et des grues, dont les plus grandes au monde, préparées pour des navires pouvant accueillir jusqu’à 25 000 conteneurs.
Comment se positionne Caucedo face à ses concurrents ?
En Amérique latine, Caucedo est dans le top 10. S’il était aux États-Unis, il serait en 7e ou 8e position. C’est une installation de poids stratégique. Dès le début, nous étions à la recherche d’un partenaire stratégique capable d’exploiter un réseau mondial. Cela assure la connectivité et la compétitivité de la République dominicaine, malgré une population de seulement 10 millions d’habitants.
Ainsi, la position de Caucedo, qui est également adossé à l’aéroport international Las Américas, en fait un élément clé de la zone franche multimodale. C’est pourquoi on l’appelle Port multimodal de Caucedo. Ce positionnement nous a amenés à développer un centre logistique que nous avons démarré il y a 7 ou 8 ans, et qui a eu d’excellentes performances.
Aujourd’hui, nous disposons d’environ 200 000 m2 d’entrepôts et nous continuons à croître. Au départ, nous avons commencé avec des bâtiments modulaires de 10 000 m2. Ensuite, nous avons évolué vers des bâtiments de quatre modules de 10 000 m2, mais nous les avons développés un à un. Actuellement, le bâtiment que nous terminons, le plus récent, mesure 42 000 m2 et a été achevé en un an et demi. Le prochain bâtiment, déjà conçu et prêt à démarrer, aura une superficie de 58 000 m2, ce qui équivaut à 624 000 ft2. Nous avançons à un rythme très rapide.
Pouvez-vous nous expliquer quel est le développement du parc industriel d’Itabo, et quelle est votre vision ?
Ce parc est un centre de fabrication et d’exportation de produits médicaux, électroniques et de santé grand public, au service de grandes sociétés multinationales, avec environ 22 000 travailleurs. Pour mettre les choses dans leur contexte, Parque Industrial Itabo SA (PIISA, ndlr) a 38 ans d’expérience.
Aujourd’hui, le programme Free Zone génère 200 000 emplois directs. En appliquant un ratio de trois pour un, cela signifie que près d’un million de personnes dépendent directement ou indirectement de ce programme.
Bien que PIISA représente donc environ 10 % de la population employée dans le programme Free Zone, nos exportations représentent 25 % de la valeur totale du programme. En effet, nos activités sont à forte valeur ajoutée.
En 2023, le programme de zone franche de la République dominicaine a exporté pour une valeur totale de 8 milliards de dollars. Sur ce montant, PIISA a contribué à hauteur de 2 milliards de dollars. Cette valeur provient principalement de deux secteurs : 60 % d’électronique et 40 % de dispositifs médicaux.
Depuis le parc, nous exportons vers 113 pays, dont des marchés clés comme le Japon, l’Allemagne et les États-Unis. Des sociétés multinationales telles que Baxter, Abbott, Johnson & Johnson et Eli Lilly ont des activités dans le parc.
Un exemple frappant est Fresenius Kabi, une entreprise allemande qui emploie 6 000 personnes au sein de PIISA. Cette entreprise, qui a débuté avec 1 600 employés il y a plus de 10 ans, a fait de PIISA son centre de fabrication mondial. Elle a déplacé les lignes de production d’Europe, y compris une opération fermée aux Pays-Bas, vers notre site en République dominicaine.
Les usines disposent de salles blanches et de fosses septiques qui pourraient être situées en Allemagne, au Japon ou aux États-Unis, mais qui se trouvent ici, en République dominicaine. Cela reflète notre capacité à livrer des produits de haute qualité, dans les délais et à des prix compétitifs au niveau international. Le modèle PIISA en a inspiré d’autres.
De plus, le pays est devenu le principal producteur de cigares au monde, avec des cigares de très haute qualité. Cette évolution reflète la capacité des Dominicains à exceller dans différents secteurs, des dispositifs médicaux aux cigares fins.
Le succès de nos opérations repose également sur le traitement réservé aux employés. Non seulement ils sont adéquatement rémunérés, mais leur éducation, celle de leurs enfants, leur santé et le bien-être de leurs communautés sont également soutenus. Cela génère un environnement de travail positif où les gens réagissent avec dévouement et professionnalisme.
Vous avez 76 ans et êtes l’un des acteurs économiques les plus importants du pays. Si vous aviez 26 ans aujourd’hui, dans quels secteurs investiriez-vous et quels seraient vos principaux objectifs ?
J’ai suivi une formation en génie civil, mais je demande toujours aux jeunes ce qu’ils veulent faire. S’ils veulent construire, je leur suggère d’étudier le génie industriel, parce qu’il se concentre sur les processus. S’ils veulent concevoir, calculer ou se spécialiser dans les sols ou les structures, c’est le génie civil qu’il faut choisir.
Tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que c’est le développement de nouvelles choses qui me passionne. L’un de mes principaux objectifs est de mettre en place des programmes qui apprennent aux jeunes à coder, ce qui leur ouvrira les portes de l’avenir.
Les opportunités ne viennent pas toutes seules. Les entreprises qui investissent ici le font parce qu’elles ont vu un modèle d’entreprise viable. Il faut des dirigeants qui les guident, les soutiennent, et croient au potentiel du pays. Je me considère comme un optimiste professionnel et je crois qu’en travaillant dur, nous pouvons continuer à nous développer en tant que pays compétitif et attractif pour les investissements.