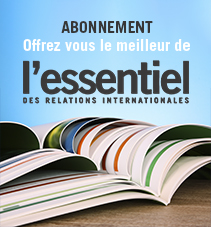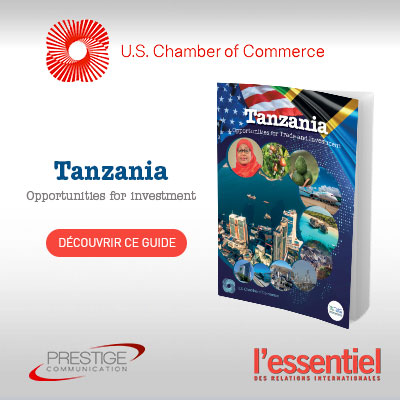L’Alliance des États du Sahel (AES), formée en réponse aux défis sécuritaires et socioéconomiques de la région, a été officiellement reconnue par les Nations unies en septembre 2023, à la suite du coup d’État au Niger de juillet 2023. Cette reconnaissance marque une étape cruciale pour l’organisation régionale, soulignant son importance croissante dans le paysage géopolitique africain.
Par Rafik Ammar
Les origines
L’AES est née de la nécessité de répondre aux crises multiples qui secouent la région du Sahel. Ses États membres, confrontés à des menaces terroristes, à l’instabilité politique et à la précarité économique, ont décidé de s’unir pour renforcer leur coopération et promouvoir un développement durable. Le contexte historique et géographique commun, incluant des réalités climatiques et culturelles similaires, a facilité cette alliance. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger partagent une histoire de luttes pour l’indépendance et une situation géopolitique complexe, caractérisée par des conflits internes et des interventions étrangères.
Le Sommet de Crans-Montana de 2024 a mis en lumière le choix des États du Sahel de créer une entité régionale capable de gérer les défis sécuritaires et de promouvoir le développement économique. Depuis septembre 2023, le communiqué des Nations unies mentionnant explicitement l’AES a été perçu comme un signe de reconnaissance internationale, soulignant l’importance de cette alliance pour la stabilité de la région.
Le principal défi auquel l’AES est confrontée est l’insécurité croissante due aux groupes terroristes opérant dans la région : Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) et Boko Haram. Ces groupes, qui profitent des frontières poreuses et de la faiblesse des États, mènent des attaques fréquentes contre les civils et les forces de sécurité. Par exemple, des raids récents ont ciblé des villages isolés, des postes de sécurité et des convois humanitaires, causant des pertes humaines et entraînant des déplacements massifs de population.
En réponse, l’AES a mis en place des initiatives de sécurité, telles que des patrouilles conjointes et des opérations militaires coordonnées pour traquer les djihadistes. Le partage de renseignements est également crucial, permettant aux forces armées nationales de réagir rapidement face aux menaces émergentes. En outre, des programmes de formation et d’équipement ont été lancés pour renforcer les capacités des forces armées locales, souvent sous-équipées et sous-entraînées. Ces efforts visent à stabiliser la région, réduire l’influence des groupes terroristes et restaurer l’autorité de l’État dans les zones affectées.
Cependant, les défis restent immenses, notamment en raison des vastes territoires à couvrir, du manque de ressources financières et logistiques, et des tensions intercommunautaires exacerbées par les violences. De plus, les sanctions internationales et les pressions externes compliquent la situation, notamment lorsque des pays membres sont confrontés à des suspensions ou des restrictions de la part de la communauté internationale.
Défis économiques et sociaux
L’AES doit également relever des défis économiques et sociaux considérables. La région du Sahel est l’une des plus pauvres du monde, avec des taux élevés de pauvreté, de chômage et d’insécurité alimentaire. Les changements climatiques exacerbent ces problèmes, rendant l’agriculture et l’élevage, qui sont les principales sources de subsistance, de plus en plus difficiles. Les États membres de l’Alliance cherchent à promouvoir une intégration économique régionale pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie des populations.
Pour ce faire, ils ont envisagé plusieurs initiatives dans le but de renforcer l’intégration économique, telles que le développement de projets d’infrastructures transfrontalières. Un exemple est le « Corridor de la route transsaharienne » (RTS), visant à relier les capitales du Sahel à la Méditerranée pour faciliter le commerce et le transport. De plus, des projets d’énergie solaire, comme le parc solaire de Gorou Banda au Niger, cherchent à diversifier les sources d’énergie et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. L’exploitation conjointe des ressources minières, notamment l’or et l’uranium, est également un domaine clé de coopération, visant à maximiser les revenus et à partager les bénéfices.
Ces efforts sont confrontés à des défis importants, notamment la nécessité d’avoir d’importants investissements financiers et une coordination efficace entre les gouvernements. Les différends politiques et les conflits d’intérêt, tels que les rivalités pour le contrôle de ressources naturelles ou les désaccords sur les politiques économiques, peuvent ralentir la mise en œuvre de ces projets et compromettre leur succès. Par exemple, les tensions liées à la gestion des sanctions économiques par la Cedeao ont parfois paralysé les initiatives concernant les infrastructures, créant des obstacles supplémentaires à l’intégration régionale.
Historique de l’Alliance des États du Sahel
L’Alliance des États du Sahel (AES), qui a vu le jour officiellement en septembre 2023, regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle est née d’un contexte d’insécurité croissante et de frustration vis-à-vis de l’action des organisations régionales et internationales, notamment la Cedeao, jugée inefficace. Elle a été formalisée lors d’un sommet historique à Bamako, où les États membres ont signé la Charte de l’Alliance visant à renforcer la coopération sécuritaire, économique et diplomatique. Cette initiative marque une volonté de ces pays de reprendre en main leur destin face aux menaces transnationales, telles que le terrorisme et le trafic d’armes.
Des échanges ouverts lors du Sommet de Crans-Montana, un tournant diplomatique
Lors du Sommet de Crans-Montana (Suisse) en juin 2024, les représentants de l’Alliance — les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali ainsi que l’ambassadeur du Niger — ont réaffirmé leur engagement pour une coopération renforcée. Les discours de Stefano Manservisi, ancien haut responsable de la Commission européenne, ou d’Emanuela Claudia Del Re, envoyée spéciale de l’Union européenne au Sahel, ont souligné l’importance de maintenir le dialogue avec les Nations unies et les partenaires internationaux, tout en affirmant la nécessité de trouver des solutions locales aux problèmes régionaux. Les discussions ont mis en avant le besoin de diversifier les alliances et de se détacher de l’influence des puissances occidentales, tout en renforçant les capacités de résilience face aux crises.
L’AES a été marquée par des tensions internes et externes, notamment à la suite des sanctions imposées par la Cedeao et soutenues par l’Union européenne. Jugées inhumaines par les populations locales, elles ont conduit à une réflexion sur l’autonomie stratégique de l’Alliance. Ses membres se sont engagés à promouvoir une gouvernance améliorée, une intégration économique renforcée et une meilleure défense collective face aux menaces communes. Ce processus inclut des projets communs d’infrastructures et de développement économique, visant à exploiter les ressources naturelles de la région pour le bénéfice direct des populations locales.
Perspectives
L’avenir de l’AES dépendra de sa capacité à surmonter les défis complexes de la région. Elle devra renforcer sa cohésion interne en établissant des mécanismes de gouvernance efficaces et en harmonisant les politiques nationales. Le dialogue et la coopération avec d’autres organisations régionales et internationales seront également essentiels pour assurer le succès de ses initiatives. La recherche de partenaires internationaux pour le financement et le soutien technique est cruciale pour faire face aux obstacles économiques et sécuritaires.
L’AES incarne une volonté ambitieuse de coopérer pour la paix, la sécurité et le développement, malgré les difficultés. Le soutien de la communauté internationale, notamment des Nations unies, est un atout majeur pour l’Alliance, mais des efforts considérables sont encore nécessaires pour réaliser ses objectifs. Elle devra naviguer entre les pressions internes et externes pour construire une région plus stable et prospère, capable de garantir la sécurité et le bien-être de ses populations.