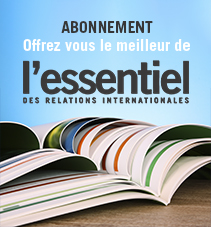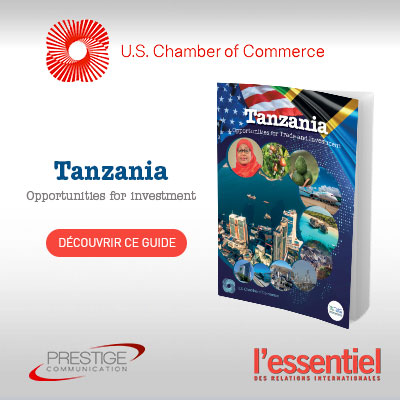Au cœur des échanges stratégiques entre l’Europe et l’Asie, la relation France-Indonésie s’impose aujourd’hui comme un exemple de coopération bilatérale en matière de défense. Alors que l’Indonésie modernise ses forces armées dans un contexte marqué par des tensions croissantes en Indopacifique, la France, puissance européenne dotée d’intérêts dans la région, se positionne comme un partenaire clé. Ce partenariat ne se limite pas à de simples transactions d’armement, mais s’inscrit dans une vision stratégique partagée, renforcée par une compatibilité diplomatique. Quels sont les moteurs et les défis de cette alliance dans un monde en mutation ?
Par Clovis Maitrot
Une convergence géopolitique dans un Indopacifique en recomposition
L’Indonésie, plus grand archipel du monde, occupe une position stratégique entre l’océan Indien et le Pacifique. Elle est traversée par des routes maritimes vitales, telles que le détroit de Malacca, le détroit de Lombok et le détroit de la Sonde, qui concentrent une part significative du commerce mondial, et se retrouve ainsi au centre de tensions géopolitiques croissantes. Jakarta doit donc relever plusieurs défis : sécuriser ses voies maritimes, faire face à la pression exercée par certaines puissances voisines (comme la Chine ou la Malaisie), et plus largement, consolider son rôle de puissance régionale incontournable dans l’Asean.
Ce contenu est réservé aux abonnés
C’est pourquoi l’Indonésie s’est engagée dans une modernisation militaire ambitieuse au travers de son programme Minimum Essential Force (MEF), lancé en 2010, qui vise à doter ses forces armées d’une capacité dissuasive crédible. Cependant, pénalisé par une flotte vieillissante et des zones immenses à couvrir, et ne disposant pas des capacités technologiques et industrielles nécessaires, le pays doit s’appuyer sur des partenaires étrangers.
Des partenariats historiques pour moderniser ses forces armées
Historiquement, l’Indonésie a fait appel à différents fournisseurs pour équiper ses armées, comme la Chine, la Russie, les États-Unis et, dans une moindre mesure, l’Australie. Cependant, ces partenariats n’ont pas pleinement répondu à ses besoins stratégiques. Avec la Chine, malgré l’achat de drones Wing Loong II, Jakarta reste méfiante en raison des différends en mer de Chine méridionale, notamment autour de ses droits sur les îles Natuna. La Russie a fourni des chasseurs Sukhoï Su-27 et Su-30, mais les sanctions internationales (CAATSA) ont bloqué un contrat clé pour des Su-35, poussant l’archipel à se tourner vers d’autres partenaires, notamment la France. Du côté des États-Unis, bien que l’Indonésie ait acquis des chasseurs F-16 Fighting Falcon, la dépendance à Washington, les conditions politiques contraignantes et les coûts logistiques élevés ont limité l’approfondissement de cette relation.
Un partenariat stratégique avec la Corée du Sud a été lancé, notamment grâce au programme conjoint KF-X/IF-X et à des initiatives navales. Cependant, des retards, des contraintes liées à des composants américains et des performances inférieures à celles voulues ont limité cette collaboration à un rôle secondaire. De son côté enfin, l’Australie, ne disposant pas d’une industrie de défense de premier plan, et en raison de tensions historiques comme sur le Timor oriental, reste un partenaire distant. C’est là que la France entre en jeu.
La stratégie française dans l’Indopacifique
La France a adopté depuis 2018 une stratégie indopacifique — région où elle possède des territoires ultramarins stratégiques (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française) —, en réponse aux tensions sino-américaines croissantes et au recul du multilatéralisme dans la zone. Cette stratégie vise à défendre l’intégralité de sa souveraineté, contribuer à la sécurité des espaces régionaux, préserver l’accès aux espaces communs, et participer au maintien de la stabilité par le multilatéralisme.
C’est en vertu de ce dernier principe que Paris privilégie des partenariats clés avec l’Inde, l’Australie, le Japon, les États-Unis et les pays de l’Asean, pour contrer les logiques unilatérales et promouvoir un ordre international fondé sur le droit.
Dans ce cadre, collaborer avec l’Indonésie constitue un atout majeur. Non seulement ce partenariat permet à l’Hexagone de prolonger son influence diplomatique et militaire dans la région, mais il offre également à l’Indonésie une alternative crédible et fiable face aux grands blocs étatiques, notamment les États-Unis et la Chine.
Encadré – Titre
La coopération militaire comme pierre angulaire de la relation bilatérale
D’importants contrats d’armement
L’accord signé par l’Indonésie pour l’achat de 42 avions de chasse Rafale en 2022 et la commande de 18 appareils supplémentaires en 2025 démontre que la coopération franco-indonésienne a gagné en consistance. Cet avion de combat multirôle, éprouvé en opérations, offre des capacités avancées telles qu’un radar AESA performant ou des liaisons de données sécurisées. Les garanties de maintenance locale et des transferts de compétences constituent des arguments forts de ces accords, en permettant à Jakarta de renforcer son autonomie stratégique tout en se préservant d’une dépendance excessive à l’égard des grandes puissances régionales. À cette commande emblématique s’ajoutent d’autres collaborations envisagées, comme la construction de sous-marins de classe Scorpène et les transferts de technologie associés.
Une coopération opérationnelle accrue
La coopération militaire entre la France et l’Indonésie s’étend également aux exercices conjoints de sécurisation maritime, à la lutte contre la piraterie et à la gestion des crises humanitaires, point essentiel dans une région sujette aux catastrophes naturelles. En parallèle, Paris partage son expertise antiterroriste pour renforcer la sécurité intérieure indonésienne face à des groupes tels que Jemaah Islamiyah, illustrant la complémentarité des priorités sécuritaires des deux pays.
Une diplomatie pragmatique et non alignée
L’Indonésie, cofondatrice et héritière du Mouvement des non-alignés (MNA) fondé en 1955 à Bandung, privilégie une autonomie diplomatique pour éviter toute dépendance à une grande puissance. Cette posture, couplée à la vision multilatérale et pragmatique de la France, fait de Paris un partenaire fiable, moins intrusif que des acteurs comme les États-Unis. Ensemble, les deux nations défendent un Indopacifique inclusif, fondé sur le respect du droit international, ce qui renforce leur collaboration assise sur une diplomatie d’égal à égal.
Défis et limites de la coopération
Malgré ses réussites, cette coopération n’est pas exempte de défis. L’Indonésie doit respecter son principe de diversification de ses fournisseurs d’armement pour limiter toute dépendance excessive, et n’hésite pas à se tourner vers des offres concurrentes. Le coût des équipements français, souvent élevé, constitue une contrainte budgétaire pour Jakarta, qui doit répondre à des préoccupations sociales et économiques internes. Par ailleurs, satisfaire les demandes d’autonomie stratégique de l’Indonésie tout en protégeant les intérêts industriels français nécessite des arbitrages soigneux. Enfin, sur le plan régional, Jakarta doit s’assurer que cette coopération ne suscite pas de méfiance parmi ses voisins de l’Asean, tels que Singapour ou la Malaisie.
La coopération franco-indonésienne en matière de défense repose sur une convergence d’intérêts : protéger les souverainetés territoriales et maritimes, et promouvoir une vision multilatérale du monde. Cela demande un équilibre subtil dans un environnement géopolitique marqué par la rivalité des grandes puissances.
La France se distingue par son offre d’équipements de pointe, comme le Rafale et les sous-marins Scorpène, couplée à des transferts de technologie, garantissant à l’Indonésie une autonomie stratégique essentielle.
Pour Jakarta, ce partenariat se révèle d’autant plus précieux qu’elle entretient des relations complexes avec les autres fournisseurs. La méfiance envers la Chine, les contraintes imposées par les États-Unis, les sanctions frappant la Russie ont permis à la France de constituer une alternative opportune.
Malgré les difficultés, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique pragmatique et équilibrée, faisant de cette alliance un modèle potentiel de coopération durable dans une région clé où se nouera une part croissante des enjeux internationaux à venir.