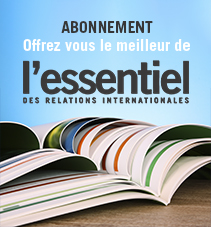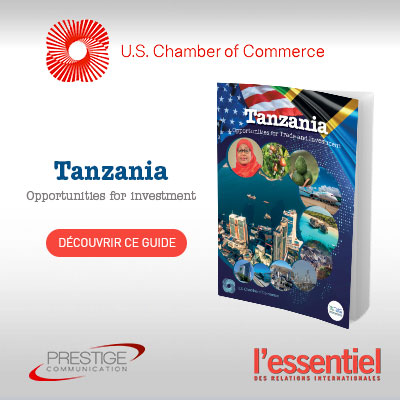Si les rapports entre l’Iran et Israël sont tendus depuis la Révolution islamique iranienne de 1979 — soit il y a près d’un demi-siècle —, l’attaque israélienne de juin 2025 a transformé la « guerre froide » qui prévalait entre les deux pays en un conflit ouvert. Les tensions, exacerbées par la situation géopolitique explosive au Moyen-Orient, ont alors atteint leur point culminant. Aujourd’hui, le devenir des relations bilatérales reste plus que jamais incertain.
Par Marie Forest
L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a ouvert une nouvelle ère de chaos au Moyen-Orient, entraînant une instabilité globale dans la région, et inquiétant l’ensemble du monde. Les ripostes israéliennes se sont enchaînées, notamment contre l’Iran, soupçonné d’avoir apporté un soutien logistique, financier et en formation à l’organisation terroriste. En quelques mois, la situation politique s’est dégradée. Quelles conséquences a, et aura, l’intensification de ce conflit ?
Ce contenu est réservé aux abonnés
La chronologie des évènements
Le 7-octobre a marqué le début de l’escalade régionale, déclenchant en représailles la guerre à Gaza et, dans le camp adverse, resserrant les liens entre les alliés du Hamas dans la région, au nombre desquels l’Iran. Son Président, Ebrahim Raïssi, tout en niant son implication, a alors soutenu le « droit légitime » des Palestiniens à se défendre. Quand des affrontements ont eu lieu avec le Hezbollah, positionné sur le sol libanais, le conflit est monté en puissance, et le chef de la diplomatie iranienne a évoqué la possibilité d’« actions préemptives » contre Israël.
Le conflit se propage à la fin de l’année. Les Houthis, alliés de l’Iran, attaquent des navires israéliens et occidentaux en mer Rouge. Une frappe aérienne israélienne tue l’un des principaux commandants iraniens du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), Razi Moussavi, en Syrie. Début 2024, d’autres responsables du CGRI sont tués à Damas, et l’ambassade iranienne est visée.
Le 13 avril, l’Iran riposte avec l’opération « True Promise », lançant plus de 300 missiles et drones contre Israël. C’est la première attaque directe de l’Iran depuis la Révolution islamique. Néanmoins, afin d’éviter toute escalade, ces tirs ont été annoncés plusieurs heures avant leur déclenchement. La contre-attaque d’Israël est en conséquence limitée, ne concernant que le système de défense antimissile iranien.
À l’été 2024, le dirigeant du Hamas palestinien Ismail Haniyeh est assassiné à Téhéran, suivi du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, à Beyrouth. Un général iranien compte aussi parmi les victimes de cet assaut. En représailles, l’Iran envoie de près de 200 missiles sur Israël : c’est l’opération « True Promise II ». La riposte est massive, ciblant les sites militaires.
L’escalade du conflit
Les hostilités ont culminé le 13 juin 2025, quand Israël a lancé une offensive sans précédent sur le sol iranien. L’opération, baptisée « Rising Lion », a consisté à détruire les infrastructures militaires, les principales visées étant les sites nucléaires de Natanz et Fordo. Plusieurs hauts responsables du CGRI sont également ciblés (leur commandant en chef, Hossein Salami, est abattu), ainsi que des scientifiques nucléaires.
L’Iran dénonce immédiatement une « déclaration de guerre » et en appelle au Conseil de sécurité de l’ONU, tout en envoyant des salves de missiles balistiques sur des villes israéliennes (Rishon LeZion, Tel-Aviv). Le coup porté reste cependant « mesuré », Téhéran ayant préalablement averti de son intention, ce qui a permis de limiter le nombre de victimes. Le conflit larvé s’est transformé en confrontation ouverte. Une guerre éclair de douze jours est déclenchée, avec l’utilisation de missiles et de drones, avant que les deux belligérants ne concluent un cessez-le-feu négocié avec l’aide des États-Unis et du Qatar.
Les conséquences régionales et internationales
L’Iran sort de ces combats très affaibli, tant militairement que diplomatiquement. Les précédentes offensives israéliennes sur les alliés de Téhéran ont mis à mal l’« axe de résistance », cette alliance politique et militaire informelle avec la Syrie et divers mouvements armés au Moyen-Orient, notamment le Hezbollah et les Houthis : le régime syrien de Bachar al-Assad est tombé ; le Hezbollah a été attaqué sur le territoire libanais ; les frappes contre les Houthis au Yémen ont décimé leurs dirigeants. Sur tous ces fronts, Tel-Aviv est intervenu depuis le massacre du 7 octobre, érodant la sphère d’influence de Téhéran.
Cette fragilisation a des conséquences à l’international. L’Iran a dénoncé la position européenne, qu’il juge trop favorable aux Israéliens, et suspendu les négociations sur le nucléaire avec les États-Unis, en cours à Oman. Téhéran s’arcboute sur ses positions et menace de se retirer du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en cas de nouvelles sanctions. Or, en juin 2025, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), avec laquelle Téhéran a cessé sa collaboration, a tiré la sonnette d’alarme, dévoilant que le pays avait déjà enrichi suffisamment d’uranium pour produire plusieurs ogives nucléaires. Face à cette situation, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont officiellement informé le Conseil de sécurité des Nations unies, le 28 août, de leur volonté de rétablir les sanctions occidentales contre l’Iran, dans le cadre du mécanisme de « snapback » prévu par l’Accord sur le nucléaire iranien (JCPoA) (cf. encadré). L’Iran et l’AIEA ont finalement conclu le 9 septembre un accord ouvrant la voie à la reprise des inspections dans les sites nucléaires du pays.
Les risques à venir
L’Iran est aujourd’hui dans une position très instable. Ses alliés sont fragilisés, son influence stratégique dans la région est affaiblie, et ses relations diplomatiques à l’international conflictuelles. En outre, la République islamique doit faire face à des désordres internes. Elle pourrait s’embraser et aller vers une guerre civile, entraînant la chute du régime des mollahs, du fait de l’opposition de plus en plus vive d’une population qui subit une répression accrue (de nombreuses arrestations et exécutions ont lieu, sur fond de soupçons d’intelligence avec l’État israélien).
Parallèlement, les tensions restent extrêmes entre les deux protagonistes de la « guerre des douze jours ». Téhéran menace d’intensifier le conflit avec Israël, qui de son côté réitère qu’il n’acceptera pas que l’Iran se dote d’une arme nucléaire. Le feu couve sous les braises, et nul ne peut prévoir quand — ni si — les relations se normaliseront. Neutraliser l’animosité des deux États pour parvenir à un statu quo pacifique sera un travail de longue haleine. L’avenir s’annonce très incertain.
Le JCPoA
L’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPoA) a été signé le 14 juillet 2015 par l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni), auxquels s’ajoutent l’Allemagne et l’Union européenne. Son objectif est de contrôler le programme nucléaire iranien et de permettre la levée progressive des sanctions économiques contre le pays.
L’Accord a été affaibli lors du retrait unilatéral des États-Unis en 2018, mais depuis 2021, des tentatives étaient faites pour rétablir un consensus entre l’Iran et les grandes puissances.
Les derniers évènements ont porté un coup d’arrêt à ce processus. Or, l’Accord prévoit un « snapback » : la possibilité de réimposer les sanctions, après une période d’avertissement de 30 jours, en cas de manquement.