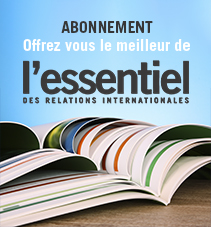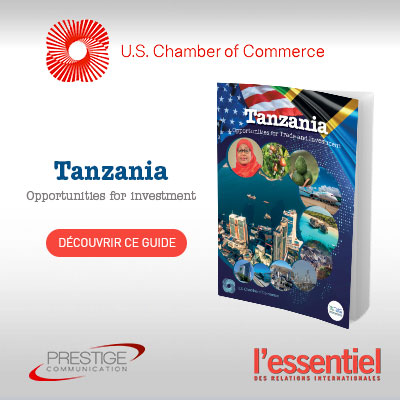Ces dernières années, l’immigration est devenue un sujet clé de la politique nationale. Progressivement, elle a été associée aux questions de sécurité, avec l’institution d’un lien systématique entre la hausse de la délinquance et l’augmentation de la population étrangère. Si les étrangers ne sont pas plus enclins à la délinquance, ce lien est cependant bien réel.
Alice De Graeve
La défiance envers les populations immigrées ne cesse de grandir, comme en témoigne la montée de partis populistes dans le monde. En France, cette tendance a pris de l’ampleur en 2017 avec l’essor du Rassemblement national dénonçant une politique migratoire trop laxiste. Alors que le Front national, représenté par Jean-Marie Le Pen, ne remportait que 10,44 % des voix lors de l’élection présidentielle de 2007, le parti, représenté par Marine Le Pen, atteignait le second tour avec 21,30 % des voix en 2017. Une tendance à la hausse confirmée en 2022 lorsque Marine Le Pen accède au second tour en remportant 23,15 % des suffrages.
Ce contenu est réservé aux abonnés
Cette percée politique répond à une montée du sentiment d’insécurité imputée à la population étrangère. Alors que l’immigration, en France, continue de croître (+0,9 % en 2024), plus de neuf Français sur dix estiment que l’insécurité a augmenté ces dernières années, d’après un sondage réalisé par Odoxa en juin 2025. Dans son rapport annuel de 2020, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) affirme aussi que plus de la moitié des Français (52 %) pensent que l’insécurité est principalement causée par l’immigration. Dans ce contexte, le rejet des populations immigrées ne peut que s’accentuer, accentué par leur diabolisation de la part de la classe politique et de certains médias.
Une délinquance plus forte
Le lien entre immigration et insécurité apparaît dans la surreprésentation des étrangers parmi les auteurs d’infractions en France. D’après les données de l’Insee, en 2019, 17,7 % des personnes mises en cause par les services de sécurité étaient étrangères. Or, cette même année, seulement 7,4 % des personnes résidant en France étaient étrangères. D’après le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), cette surreprésentation s’observe dans la plupart des principaux pays d’accueil.
Cependant, le CEPII tend à relativiser ces chiffres. D’une part, certaines infractions ne peuvent, par définition, être commises que par des étrangers. C’est le cas des entrées ou des séjours irréguliers sur le territoire, du travail sans titre de séjour ou encore de la non-exécution d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).
D’autre part, le CEPII évoque une différence de traitement entre les étrangers et les Français au sein du système judiciaire. Selon une étude du ministère de la Justice, pour une même infraction, avec les mêmes antécédents judiciaires et les mêmes caractéristiques individuelles, l’écart de peine est de 4,5 points de pourcentage. Aussi, les étrangers ont une probabilité plus forte que les Français d’avoir une peine de prison ferme (5 points de pourcentage), avec une durée également plus longue de 22 jours. S’il peut s’agir d’une inégalité de traitement manifeste, ces écarts peuvent aussi reposer sur des critères légaux de détermination des peines, comme l’insertion professionnelle de l’individu ou son statut familial. Cependant, les étrangers ayant des difficultés d’accès à l’emploi et immigrant souvent seuls, ils sont nécessairement pénalisés par ces critères.
Un risque d’infraction accru
Si le rapport entre immigration et délinquance ne peut être contesté, les populations immigrées ne présentent pas de dispositions particulières à la délinquance à leur arrivée sur le territoire français. Ce lien serait conjoncturel.
La notion de migration constitue déjà un facteur de risque d’augmentation de la délinquance, de par la hausse, parfois soudaine, de la population du pays d’accueil. On parle d’ailleurs de « vagues migratoires » car les individus fuient souvent en nombre une situation difficile dans leur pays d’origine. Ces déplacements sont donc visibles, et renforcent le sentiment d’insécurité. Or, en augmentant la population sur un territoire donné, le risque que plus d’infractions soient commises croît mathématiquement de façon conjointe.
De plus, les hommes jeunes sont surreprésentés dans la population immigrée, du fait notamment de la dangerosité du voyage. Or ce segment de population est associé à un taux de délinquance plus élevé. En augmentant le nombre d’hommes, jeunes, dans la population française, le nombre d’infractions commises a davantage de risques d’être également en hausse.
En outre, les étrangers, lorsqu’ils s’installent dans un pays d’accueil, ne se dispersent pas sur tout le territoire. Ils se regroupent près des frontières ou en périphérie des grandes villes, où se concentrent le plus d’opportunités professionnelles et où les loyers sont plus abordables. Ces regroupements peuvent aussi être recherchés afin de former des communautés.
Le sentiment d’appartenance à un groupe est effectivement essentiel pour tout individu et, dans le cas de l’immigration, la perte de repères liée au déplacement peut accroître ce besoin de partage d’une expérience commune. Ces regroupements accentuent l’augmentation de la population immigrée dans certains territoires, les rendant plus sujets à une croissance du nombre d’infractions, sans pour autant que le taux d’infraction par habitant n’augmente.
La marginalisation en cause
Si ces étrangers choisissent de s’installer près des villes en pensant y trouver du travail, l’accès au marché de l’emploi est souvent ardu. Ceux arrivés illégalement rencontrent une difficulté supplémentaire liée à l’inemployabilité des travailleurs sans papiers : l’embauche de personnes ne détenant pas d’autorisation de travailler en France est illégale, et peu d’employeurs s’y risquent. Lorsqu’ils passent outre, les tâches sont répétitives et demandent un effort physique conséquent pour une rémunération très faible.
Cependant, l’accès à l’emploi n’est pas nécessairement aisé pour les personnes ayant immigré légalement. « Certains, en arrivant, sont déjà bilingues, mais pour de nombreux étrangers l’apprentissage de la langue est très difficile », explique une source de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). « Ils ont parfois plus d’une soixantaine d’années et utilisent un alphabet différent depuis leur enfance, ils ne peuvent pas réapprendre, à ce stade, une toute nouvelle langue. » Des difficultés qui se rencontrent également dans l’accès à l’éducation et à la formation, qui seraient pourtant des leviers pour trouver un emploi. Or, en avril 2023, le CEPII relevait le lien entre accès à l’emploi et délinquance. Il constatait que les pays d’accueil offrant plus d’opportunités d’emploi aux populations immigrées pouvaient voir leur taux de délinquance baisser. En effet, le travail est un pilier d’intégration sociale. Face à la difficulté d’en avoir un, les étrangers se retrouvent souvent marginalisés, ce qui peut engendrer une défiance vis-à-vis du pays d’accueil.
Outre une inclusion sociale rendue difficile par les conditions d’accès à l’emploi, les étrangers peuvent aussi subir un racisme qui tend à les marginaliser davantage. D’après un sondage Ipsos de 2023 relatif aux fractures françaises, 64 % des Français disent ne plus se sentir « chez eux comme avant » dans leur pays. Ce sentiment s’accompagne d’une violence accrue envers les étrangers. Le ministère de l’Intérieur relève en 2024 une augmentation des crimes et délits à caractère raciste de 11 % par rapport à l’année précédente, avec 9 400 faits enregistrés par les services de sécurité. Le Gouvernement souligne notamment une surreprésentation des ressortissants d’un pays d’Afrique parmi les victimes des infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux. Or, d’après les données du ministère de l’Intérieur, en 2024, près de 35 % des bénéficiaires d’un premier titre de séjour venaient d’Afrique, les ressortissants des pays du Maghreb restant les plus nombreux. Si l’arrivée des populations immigrées peut aggraver la hausse des infractions à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, ces comportements sont susceptibles de développer une défiance des étrangers envers le pays d’accueil et d’accentuer leur marginalisation.
Or, la marginalisation est un véritable levier de délinquance. L’intégration sociale et l’appartenance à un groupe poussent l’individu à consentir aux règles et à s’adapter aux habitudes de ce groupe. S’en sentir exclu peut amener à s’y opposer, notamment en commettant des infractions. C’est pourquoi l’État a mis en place différents dispositifs afin de favoriser l’intégration des populations immigrées. Au travers du Contrat d’intégration républicaine (CIR), l’OFII tente d’aider les étrangers arrivant sur le territoire. La signature de ce contrat est obligatoire pour une grande partie des immigrés légaux pour l’obtention d’un titre de séjour. Ils s’engagent à suivre une formation civique, relative au fonctionnement des services publics et au respect des valeurs républicaines, ainsi qu’une formation à la langue française.
Mais ces formations, financées par l’État pour garantir un accès égalitaire à tous, sont organisées sur plusieurs journées et certains étrangers ne s’y rendent pas, étant déjà engagés dans un emploi. Elles ne sont donc pas adaptées à tous. D’après un ex-agent de l’OFII, « en 2020, aucune formation, civique ou linguistique, n’était adaptée aux personnes en situation de handicap, tous types de handicap confondus. […] L’intégration des immigrés souffre aussi d’un manque important de moyens. Le sous-effectif et l’absence de solution effective, notamment sur la question du logement de ces populations, freine l’efficacité de ces dispositifs. » Si l’État cherche donc des solutions pour améliorer l’intégration des étrangers en France, celles-ci restent à ce jour insuffisantes pour réduire leur marginalisation.
Le rôle des médias
Les actes racistes sont en hausse dans le pays ces dernières années. L’idée qu’immigration et insécurité vont de pair est très répandue parmi les Français. Mais David Fonte et Solveig Lelaurain démontrent dans leurs recherches sur « la figure du jeune de banlieue dans la construction sociale du harcèlement de rue » que cela est dû à leur imaginaire. Les personnes interrogées ont souvent décrit le harceleur de rue comme « un étranger ou un Arabe » lorsque la consigne était de se substituer aux « Français en général ». Pourtant, lorsqu’elles devaient s’exprimer en leur propre nom, la description du harceleur de rue était moins portée sur des origines étrangères.
L’influence des médias dans cette perception des étrangers en France doit être interrogée. Le CEPII estime qu’il existe des biais médiatiques créant l’illusion d’un lien systématique entre délinquance et immigration. Ces dernières années, la tendance s’est développée dans les médias d’insister sur l’origine étrangère de l’auteur de faits délictueux, qu’il soit ou non de nationalité française. À l’inverse, l’omission est de mise lorsque l’auteur des faits est de nationalité française et d’origine caucasienne.
Ce biais médiatique contribue à la hausse du sentiment d’insécurité face aux populations immigrées. Cela a développé une certaine méfiance, visible notamment sur les réseaux sociaux. Hauts lieux du lancement d’alertes, les médias relaient régulièrement les faits divers sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Or, on s’aperçoit que les internautes ont pris pour habitude de relever ou de questionner le pays d’origine, l’ethnie ou la nationalité de l’auteur des faits divers.
D’après un sondage Odoxa réalisé en juin 2025, 91 % des Français estiment que l’insécurité a augmenté en France ces dernières années. De plus, 71 % des jeunes ressentent une forme d’insécurité au quotidien ; or, ils utilisent abondamment les réseaux sociaux, sur lesquels le racisme ordinaire se développe. Les biais médiatiques encouragent la montée du racisme et de la discrimination envers les populations immigrées, amplifiant davantage leur marginalisation. Elle peut aussi être un facteur de la hausse du sentiment d’insécurité.
Sécuriser l’immigration
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que le véritable lien entre immigration et insécurité concerne majoritairement la sécurité des immigrés. Elle constate que, depuis les années 1990, l’intérêt porté à ces populations baisse et leur sécurité est moins préservée. Ce désintérêt est causé notamment par la désinformation et la propagation, médiatique et politique, de l’idée selon laquelle les étrangers pourraient mettre à mal la sécurité nationale.
La véritable question sécuritaire autour de l’immigration porterait sur le parcours migratoire. Les moyens de transport utilisés sont souvent dangereux. Chaque année, des embarcations coulent en Méditerranée alors que des milliers de personnes tentent de rejoindre les côtes européennes. À l’arrivée, ces étrangers se heurtent à des comportements xénophobes ou racistes.
En France, les étrangers voient leur sécurité menacée. D’après le ministère de l’Intérieur, en 2024, le pourcentage de victimes étrangères est supérieur à celui des étrangers résidant en France pour la plupart des types d’infraction enregistrés.
Les migrations sont majoritairement entreprises par des individus qui souhaitent garantir leur sécurité, parfois menacée dans leur pays d’origine, ou améliorer leur qualité de vie. Pourtant, la surreprésentation des étrangers dans la victimation française permet d’affirmer qu’ils sont les principales victimes de l’insécurité.