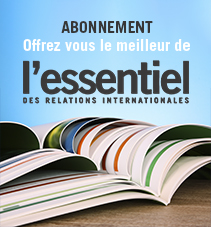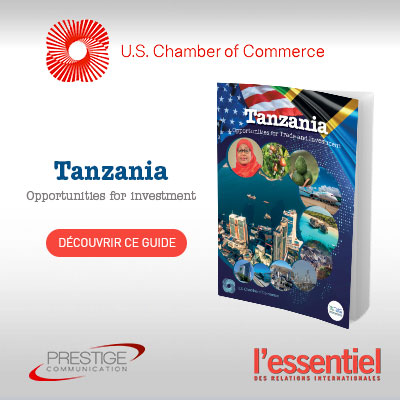La Chambre fédérale de commerce et d’industrie du Burundi (CFCIB) est l’organisation faîtière du secteur privé. Son Président nous en présente les forces, et nous livre son regard sur le secteur privé burundais.
Propos recueillis par Laurent Bou Anich
Pouvez-vous nous présenter la CFCIB, que vous dirigez depuis 2022 ?
Cette fédération compte actuellement quatorze chambres sectorielles correspondant à quatorze secteurs de l’économie nationale, et deux chambres transversales, à savoir la Chambre des femmes entrepreneurs et la Chambre des jeunes entrepreneurs. D’autre part, elle compte également dix chambres transversales provinciales. La CFCIB compte par ailleurs trois grandes entreprises. D’ici peu, le nombre de chambres sectorielles sera porté à seize car la Chambre sectorielle des banques, assurances et microfinance va éclater en trois chambres sectorielles indépendantes.
Ce contenu est réservé aux abonnés
Au niveau de sa structure juridique, la CFCIB est une association sans but lucratif et se veut indépendante. Son président est élu par les membres au suffrage universel direct pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. La fédération dispose de sa propre radio, dont la ligne éditoriale est commerciale. Le nombre d’entreprises membres de la CFCIB dépasse la barre des 2 000. La fédération est le partenaire attitré aussi bien du Gouvernement que des partenaires techniques et financiers sur toutes les questions ayant trait à l’organisation du secteur privé, au climat des affaires, à la plaidoirie pour toutes les questions fiscales et douanières.
De surcroît, la CFCIB est l’interlocuteur de toutes les organisations du secteur privé dans les communautés économiques régionales dont le Burundi est membre, en l’occurrence la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).
Selon vous, quels sont les principaux atouts et forces du Burundi ? Quel est le potentiel du pays pour le commerce et l’industrie ?
Nous avons une population très jeune, dont 65 % a moins de 35 ans. Nous disposons également d’un nouveau Code des investissements très attrayant, avec des avantages fiscaux et non fiscaux.
Le Burundi est une terre vierge pour l’investissement. Au stade actuel, il dispose d’un tissu industriel encore embryonnaire, à telle enseigne que les exportations couvrent à peine 20 % des importations, ce qui donne une balance commerciale lourdement déficitaire.
Le Burundi enregistre une forte pluviométrie avec neuf mois de pluies sur douze. Le pays dispose ainsi d’un réseau hydrographique très dense, qui offre un potentiel irrigable immense.
Bien que la population burundaise oscille autour de 13 millions en 2024, le marché d’écoulement va loin au-delà. La CAE, qui compte déjà huit pays, est un vaste marché de plus de 300 millions d’habitants, et c’est la communauté économique régionale la plus avancée du continent. En effet, le Marché commun est-africain et le Territoire douanier unique sont déjà opérationnels.
En d’autres termes, l’industrie burundaise a un accès libre à l’ensemble de la communauté, sans barrière tarifaire, avec comme passeports de ses produits les certificats d’origine. Le Burundi est au centre de toutes les communautés régionales africaines et peut constituer, à ce titre, un hub, une plaque tournante du commerce dans la région.
Le lac Tanganyika constitue un atout majeur pour le commerce, en ce sens qu’il permet de relier l’Afrique australe au Rwanda, à l’Ouganda et au Kenya via le port de Bujumbura, aujourd’hui en cours d’extension et qui verra la capacité de ses manutentions doubler.
La liste des atouts du Burundi me paraît interminable, mais il sied de souligner également que nous disposons d’une main-d’œuvre qualifiée et certainement la moins chère du monde, où un ouvrier qualifié touche cinq dollars par jour.
Vous avez effectué la majeure partie de votre carrière au sein de Savonor. Vous connaissez bien le secteur industriel privé. À quelles difficultés est-il confronté ?
Savonor, qui compte aujourd’hui plus de 2 000 emplois directs — sans parler de dizaines de milliers d’emplois indirects —, est une entreprise bien connue dans tous les coins et recoins de la République du Burundi. Elle a su adapter et tailler sa politique commerciale au niveau des moyens des plus humbles Burundais.
Néanmoins, depuis quelques années, Savonor est confrontée à une pénurie de devises qui freine son expansion et ses ambitions, faute de matières premières accessibles. Dans ce contexte, l’achat de nouveaux équipements, de pièces de rechange pour les machines est une véritable équation à plusieurs inconnues. Savonor est dans l’incapacité de contracter des crédits auprès d’institutions bancaires africaines ou internationales car elle ne peut pas rembourser en devises.
À ce tableau s’ajoute un manque d’électricité et l’entreprise, qui devrait fonctionner 24 h/24, doit fermer ses portes à 17 heures, comme si elle était une administration publique.
Toutefois, Savonor reste armée de courage et porte une vision à long terme. Elle a procédé à de nouvelles plantations de palmiers à huile à Bujumbura et à Rutana, en vue d’accroître en quantité et en qualité nos matières premières locales. Sur le plan marketing, Savonor a décidé d’apporter toute une panoplie de nouveaux produits dans le cadre de l’import-substitution.
Quelles actions mettez-vous en place pour participer à l’essor de l’entrepreneuriat et à l’investissement au Burundi ? Que faut-il améliorer, et comment travaillez-vous avec les autorités du pays pour promouvoir les investissements au Burundi ?
L’entrepreneuriat peine à décoller au Burundi pour plusieurs raisons. Le système éducatif classique ne répond pas aux besoins de l’entrepreneuriat. En effet, nous vivons dans un système encore très élitiste où les écoles techniques professionnelles tournent autour de 20 % par rapport aux autres établissements d’enseignement secondaire. De surcroît, même les écoles techniques professionnelles qui existent sont sous-équipées. En ma qualité d’industriel, je peux affirmer haut et fort qu’il n’y a pas d’adéquation formation-emploi.
Il faut repenser, voire refondre notre système éducatif pour l’adapter aux besoins des entreprises. La CFCIB marche côte à côte avec le Gouvernement pour renverser la vapeur. Aujourd’hui, à travers un projet de formation professionnelle sur financement de l’Enabel, les entreprises du secteur privé offrent des stages professionnels aux apprenants.
Je voudrais d’ailleurs en passant saluer les efforts de la Belgique, qui vient de démarrer un nouveau programme 2024-2028 sur la formation et l’insertion professionnelles avec une enveloppe de 16 millions d’euros.
En ma qualité de président de la CFCIB, je suis automatiquement président du conseil d’administration de l’Agence de développement du Burundi (ADB), et la CFCIB négocie et signe des partenariats avec d’autres chambres de commerce du monde pour mieux drainer les investissements étrangers. À titre informatif, la CFCIB vient de signer ces derniers mois des mémorandums d’entente avec les chambres de commerce du Qatar et d’Abu Dhabi.
Comment la CFCIB contribue-t-elle à orienter le Gouvernement pour améliorer le climat des affaires ?
La CFCIB a contribué de façon significative au redémarrage du cadre permanent de dialogue public-privé, en panne depuis 2015. Le Conseil des ministres vient de valider le décret de création du Cadre de dialogue public-privé et la fédération a participé activement à l’élaboration de ce texte.
Depuis 2022, il existe une Journée nationale consacrée au secteur privé, « Umuzinga Day », placée sous l’égide de Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, Général-Major Évariste Ndayishimiye. C’est dans ce cadre que le Chef de l’État a formellement recommandé que le Premier ministre rencontre désormais les acteurs du secteur privé trimestriellement. Le Ministre du Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme devra quant à lui rencontrer le secteur privé chaque mois. En vue de débattre de toutes les questions fiscales et douanières, la CFCIB et l’Office burundais des recettes doivent se réunir chaque mois également.
Lors de ses missions économiques en dehors du pays, le Chef de l’État tient toujours à avoir à ses côtés une délégation d’hommes d’affaires pour nouer des partenariats avec d’autres entreprises ou pour un transfert de technologies. En juillet 2020, à l’aube de sa législature, le Président burundais a qualifié le secteur privé d’« état-major du développement ».