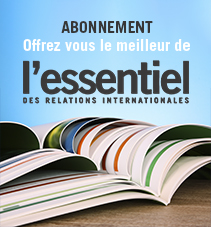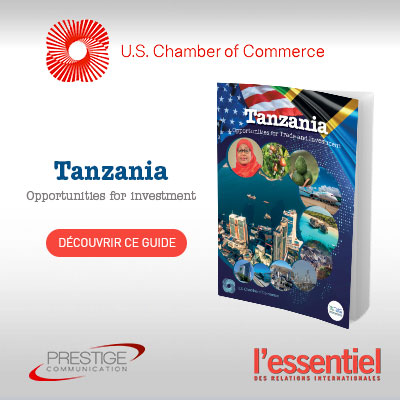L’histoire de l’Indonésie est jalonnée de remarquables transformations, qui l’ont fait passer de territoire colonial à troisième plus grande démocratie du monde. C’est la chronique d’une nation qui a émergé de siècles de domination étrangère pour devenir un exemple d’islam modéré, de gouvernance démocratique, de croissance économique et d’harmonie culturelle en Asie du Sud-Est, et au-delà.
Par Feliana Citradewi
L’héritage colonial et les graines du nationalisme
Pendant plus de trois siècles, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), et plus tard le Gouvernement néerlandais, ont contrôlé l’archipel indonésien, exploitant ses épices, son caoutchouc, son pétrole et autres ressources. Fondée en 1602, la VOC devint la première véritable corporation multinationale de l’histoire, faisant des îles indonésiennes une plaque tournante du commerce mondial. Au milieu des années 1600, elle contrôlait 150 navires marchands, 50 000 employés et une armée privée de 10 000 hommes. Les épices indonésiennes — noix de muscade, clou de girofle et macis des îles Moluques —, autrefois essentielles pour conserver la viande, générèrent d’immenses profits qui financèrent les canaux d’Amsterdam et la domination maritime de la Hollande. Dix livres de noix de muscade achetées pour moins d’un penny anglais aux îles Banda pouvaient se vendre en Europe plus de deux livres sterling, une différence de plus de 60 000 %. En ayant le monopole du commerce des épices et en les vendant 14 à 17 fois le prix d’achat, la VOC devint sans doute l’entreprise la plus profitable de l’histoire. Le cultuurstelsel (« système de culture ») colonial forçait les fermiers à réserver des terres pour les cultures d’exportation, enrichissant les Néerlandais en appauvrissant des millions d’Indonésiens.
Un mouvement nationaliste naquit de cette oppression. Au début du XXe siècle, des intellectuels tels que Sukarno imaginèrent l’indépendance de l’Indonésie. L’idée était révolutionnaire car ce pays unirait diverses ethnies, langues et cultures. En 1928, le Serment de la Jeunesse (« une patrie, une nation, une langue ») posa la base idéologique de l’indépendance. L’occupation japonaise (1942-1945), quoique brutale (on estime à 4 millions le nombre d’Indonésiens tués), accéléra le mouvement. La jeunesse indonésienne se saisit de l’opportunité pour obtenir l’indépendance.
La naissance d’une nation : proclamation et révolution
Le moment qui changea l’histoire de l’Asie du Sud-Est arriva le 17 août 1945, quand Sukarno lut la proclamation du haut de sa véranda à Jakarta. Par les mots : « Nous, le peuple d’Indonésie, déclarons par la présente l’indépendance de l’Indonésie », lui et Mohammad Hatta lancèrent la Révolution nationale indonésienne. Ce ne fut pas une simple cérémonie, mais le début de 4 ans de lutte brutale. Les Néerlandais, ne voulant pas perdre leur colonie la plus profitable, déclenchèrent des opérations militaires, causant la mort de 97 000 à 100 000 Indonésiens, et de milliers de soldats néerlandais et britanniques. La révolution montra l’unité indonésienne, différentes ethnies combattant ensemble pour l’indépendance. Peu à peu, la pression internationale, y compris venue des États-Unis, força les Néerlandais à accepter leur défaite. Après presque 350 ans d’autorité néerlandaise et 5 ans de conflit, la souveraineté de l’Indonésie fut reconnue internationalement en 1949.
La « démocratie dirigée » de Sukarno et les défis de l’unité
En tant que premier Président de l’Indonésie, Sukarno dut affronter la tâche monumentale d’unifier une nation incroyablement diverse. Dès le début, les pères fondateurs décidèrent de ne pas faire du pays un État islamique, et optèrent pour la diversité. La vision de Sukarno d’« unité dans la diversité » (Bhinneka Tunggal Ika) devint la devise nationale, soulignant que malgré des centaines d’ethnies et de langues, l’archipel ne formait qu’un seul peuple. Il établit la Pancasila — cinq principes : la croyance en Dieu, l’humanitarisme, l’unité nationale, la démocratie et la justice sociale — comme base philosophique de la nation.
Cependant, la « démocratie dirigée » de Sukarno (1957-1965) devint de plus en plus autoritaire. Les problèmes économiques augmentèrent car le Président réalisait de coûteux projets de prestige. Il devait en outre jongler avec diverses forces, comme les militaires, les partis nationalistes et le Parti communiste indonésien (PKI). Sa rhétorique anti-occidentale et ses liens étroits avec la Chine et l’Union soviétique attisèrent des tensions internationales pendant la guerre froide. Mais son idéologie de non alignement demeure sur la scène internationale comme une politique étrangère intemporelle, libre et active.
L’ère Suharto : ordre, croissance et répression
Les violents évènements du 1er octobre 1965, quand le « Mouvement du 30 septembre » enleva et assassina six généraux d’armée, changèrent le cours de l’histoire de l’Indonésie. Le général Suharto, qui survécut à la tentative de coup d’État, prit peu à peu le pouvoir et établit le régime de l’« Ordre nouveau », qui dura de 1966 à 1998. Au cours de ces 32 ans, l’Indonésie connut une transformation spectaculaire guidée par des économistes éduqués aux États-Unis et soutenus par l’aide occidentale et des investissements. Le pays devint un laboratoire de néolibéralisme, avec une restructuration de la dette liée à des politiques de libéralisation du marché similaires à celles du Chili sous son régime militaire. L’archipel connut une croissance élevée, réduisit la pauvreté, augmenta la production pétrolière, construisit des écoles, augmenta son taux d’alphabétisation et développa des infrastructures reliant des îles éloignées, ce qui en fit une puissance régionale montante.
Mais ces progrès, le coût politique et social fut très lourd : censure, domination militaire, suppression de l’opposition et violation des droits humains. Le régime de Suharto devint synonyme de « KKN » (corruption, collusion et népotisme), tandis que sa famille et son cercle rapproché s’enrichissaient. Plus tard, Transparency International estima qu’il avait détourné entre 15 et 35 milliards de dollars, faisant de l’« Ordre nouveau » l’un des régimes les plus corrompus de l’histoire moderne. Sa chute en 1998 survint après des manifestations de masse et des émeutes violentes, y compris des attaques sur la communauté des Chinois d’Indonésie (Tionghoa). L’héritage de ce régime est une croissance économique profondément mêlée d’autoritarisme, de corruption systémique et de cicatrices sociales durables.
La transformation démocratique : l’ère de la Réforme
La crise financière asiatique de 1997 avait exposé les fragilités du système Suharto. La roupie indonésienne chuta : pour un dollar, on passa de 2 600 roupies en août 1997 à plus de 14 800 en janvier 1998. Cette dévaluation vertigineuse déclencha des troubles sociaux de grande ampleur. Manifestations d’étudiants, effondrement économique et pression internationale forcèrent Suharto à démissionner le 21 mai 1998, mettant un terme à 32 ans de régime autoritaire.
L’ère de la Réforme qui suivit est celle de la troisième grande transformation de l’Indonésie. Le pays engagea des réformes démocratiques radicales, dont la liberté de la presse, des élections multipartites, une autonomie régionale et des réformes militaires. Des amendements de la Constitution établirent la limitation des mandats ainsi que des protections renforcées des droits humains, et créèrent de nouvelles institutions démocratiques.
L’Indonésie moderne : histoire d’un succès démocratique
L’Indonésie d’aujourd’hui prouve que de grandes nations diverses à majorité musulmane peuvent être des démocraties stables et prospères. Depuis 1998, le pays a tenu de nombreuses élections libres et justes, où les transferts de pouvoir paisibles sont devenus la norme, et a géré les mouvements séparatistes à Aceh tout en stabilisant des régions précédemment agitées.
Sous le Président Prabowo Subianto, entré en fonction en octobre 2024, l’Indonésie poursuit sa trajectoire démocratique tout en s’attaquant aux défis économiques. L’Administration vise une croissance annuelle de 8 %, et le statut de pays à haut revenu d’ici 2045, pour le centenaire de l’indépendance.
La trajectoire de l’Indonésie, de la domination coloniale à la démocratie, en passant par la révolution, l’indépendance et l’autoritarisme, montre que « l’unité dans la diversité », la croissance économique et la liberté politique peuvent coexister. La nation prouve qu’un pays né de la lutte peut favoriser la stabilité régionale et la coopération mondiale.