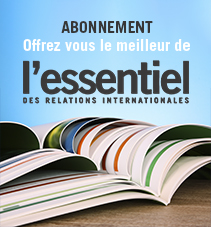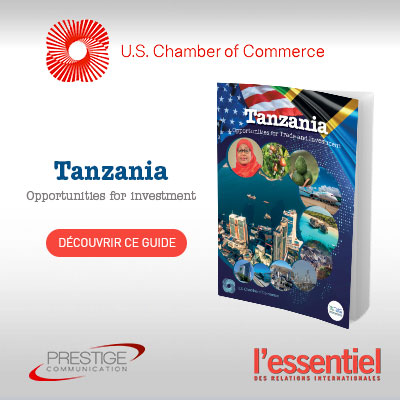Si le lac Tanganyika ou les tambourinaires du Burundi ne sont plus à présenter, d’autres merveilles naturelles, préservées, méritent amplement d’être découvertes, et mises en valeur pour le tourisme.
Par Stanislas Gaissudens
Les lacs du nord du Burundi
Au nord du Burundi, à la frontière avec le Rwanda, une série de huit lacs — Cohoha, Gacamirindi, Gitamo, Kanzigiri, Mwungere, Narungazi, Rweru et Rwihinda — offre un spectacle naturel impressionnant. Ils font partie du bassin versant du fleuve Nil et constituent par excellence un potentiel touristique sous-régional en quête de mise en valeur.
Ce contenu est réservé aux abonnés
C’est également un lieu de vacances pour des oiseaux européens. Parmi les 694 espèces d’oiseaux migrants que le Burundi abrite, selon l’Unesco, des centaines quittent l’Europe en décembre pour y retourner au mois d’avril ; 31 espèces profitent du climat favorable sur le lac Rwihinda, d’où son surnom de « Lac aux oiseaux ».
Le lac Rwihinda fait partie des must-see du Burundi. Il couvre une superficie de 425 ha et constitue un lieu de passage et d’hibernation pour les oiseaux migrateurs, soit environ 20 espèces. Il comprend un îlot central, dont le nom est Akagwa, et des îlots secondaires tourbeux flottants qui se déplacent au gré du vent, constituant un habitat de prédilection, un lieu de ponte et de nidification pour certains oiseaux migrateurs.
La richesse écologique, spécificité de ce lac, est constituée de plantes aquatiques, notamment des nénuphars, des Potamogeton et des plantes de marais comme les papyrus. On y trouve aussi des reptiles comme les Dasypeltis scabra, des batraciens et des poissons spécifiques. Au-delà du lac s’observe une savane composée de quelques acacias et de Combretum.
Le massif de Nkoma
Les Monuments naturels de l’Est (MNE) sont des exemples de sites d’une beauté naturelle incroyable, à ne pas manquer lors d’une visite au Burundi. Ils se localisent sur le massif sacré de Nkoma, situé au sud-est du pays, en province de Rutana. De par leur richesse biologique et les évènements socioculturels du Burundi monarchique, ils occupent une place capitale dans l’histoire du pays, ainsi que dans l’histoire environnementale et géoculturelle de la région. Ils forment un panorama harmonieux et enchanteur, sur une très vaste superficie verdoyante.
Sur le massif de Nkoma, des monuments naturels incroyables, constitués de la faille de Nyakazu ainsi que des chutes et de la grotte de Karera, s’offrent aux yeux des visiteurs. Grâce à leur beauté, cette région est la plus visitée par les touristes après les belles plages du lac Tanganyika.
Les chutes
Soigneusement installées au sein du massif de Nkoma, les chutes sont orientées du nord au sud et s’étendent sur 142 ha. Elles sont divisées en six branches et réparties sur trois paliers, formant une véritable cascade d’eau en chute libre.
Au premier niveau se trouve la chute principale, qui se scinde en deux branches parallèles d’une longueur estimée de 80 m, lesquelles se déversent dans un bassin. Cette chute comprend plusieurs cascades de tailles différentes entrecoupées par deux plateformes.
À l’ouest de cette chute principale se trouve une autre cascade aussi importante, de 50 m environ. Les eaux de ces deux chutes convergent sur un deuxième palier gigantesque, pour former la troisième cascade qui se déverse sur la vallée.
Ces eaux coulent à travers une galerie forestière entourée d’une savane à forte population de primates et d’herbivores, dont des singes, des gazelles et des antilopes.
C’est à partir de 1980 que les chutes et la grotte de Karera ont été instituées en aires protégées.
La faille de Nyakazu
La faille de Nyakazu, ou faille des Allemands, est une entaille dans le massif de Nkoma qui surplombe la plaine et se prolonge jusqu’à la frontière avec la Tanzanie. Cette faille est d’origine tectonique récente et s’étend sur 600 ha. Elle présente une structure exceptionnelle. On y trouve des vestiges historiques d’un fort allemand.
On observe également une chute saisonnière imposante, d’une hauteur de plus de 100 m, qui se déverse sur une vallée couverte d’une forêt constituée de différentes espèces, notamment l’Entandrophragma excelsum. Autour de la faille, il existe une forêt claire de Brachystegia. C’est une zone de conservation d’arbres de haute altitude, qui jouit d’un microclimat particulier.
Les espèces fauniques ne sont pas toutes inventoriées, mais on peut observer des mammifères et des espèces ornithologiques.
Parcs et réserves du Burundi
Le Burundi possède aujourd’hui 15 aires protégées, réparties en parcs nationaux, réserves naturelles, monuments naturels et paysages protégés. Ils couvrent environ 1 040 km2, soit 3,7 % de la superficie totale du pays.
Ces sites ont une réserve de biodiversité de premier plan. On y observe des primates, des prédateurs, ainsi que de multiples sortes d’oiseaux. Les chimpanzés sont visibles dans différents secteurs.
De par la situation géographique particulière du Burundi, sa flore et sa faune comprennent à la fois des espèces appartenant à la région afro-montagnarde, à l’Afrique de l’Est, à l’Afrique zambézienne et à l’Afrique centrale. De plus, le relief accidenté et les variations d’altitude (de 266 à 780 m) permettent une hétérogénéité de milieux. Malgré l’exiguïté de son territoire, le pays est ainsi biologiquement fort riche. Il l’est même nettement plus que son voisin du nord, le Rwanda, bien que ce dernier possède, dans la région de Birunga, des zones de très haute altitude, dites afro-alpines, qui manquent au Burundi. Cette richesse se remarque surtout au niveau de la flore : le Burundi possède presque deux fois plus d’espèces de graminées et d’orchidées.